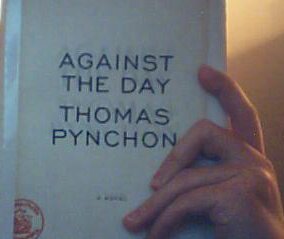In Memoriam
Gribouille. Avril 1991 - Décembre 2006. Il aimait le thon et le filet de porc. Il adorait ronronner sur mes genoux lorsque je lisais un bon livre. Un être unique, une sale façon de finir l'année sur une note un peu pathétique.
Parlons musique
Il faut tout de même préciser que les échos de guitares continuent à me bercer, même si de façon nettement moins fréquente. Pendant des années, l’autre créature a composé minutieusement son top des douze mois écoulés. Elle élaborait une longlist comptant des dizaines d’albums, les réécoutait tous pour déterminer une shortlist, réécoutait tous pour réduire la sélection à vingt titres, réécoutait tous pour lui donner un ordre plus ou moins conséquent. C’est fini tout ça, mais Fausto veut vous parler des deux, trois choses l’ayant accompagné en 2006. Oyez, Oyez !
Une année ne peut pas être complète sans un petit truc de Sunn. Cette fois-ci, on ne devra pas se contenter d’une sortie ultra-limitée, puisque l’infâme monstre des infrasons offre une saisissante collaboration avec le meilleur groupe japonais, Boris. Cette rencontre donne « Altar », un album parfait, monumental. Ce n’est ni du Sunn, ni du Boris, c’est un étrange amalgame. Bien sûr, ça drone sec, ça fait bzzz et hmmmmm et urrrrrrhhhhhhhhhhh, ça agite les entrailles, ça retourne les cœurs, ça fait baisser la tête, lever les bras, tordre les mains. Bien sûr. Mais Sunn devient plus psyché grâce à la guitare de Wata, la basse de Takeshi et la batterie d’Atsuo. Mais Boris devient plus sombre par l’intervention divine et totalement grim de Steve O’Malley et Greg Anderson. Mais ces monstres donnent aussi dans la berceuse lorsque Jesse Sykes débarque. Mélodieuse œuvre démontrant, si c’est encore nécessaire, que indeed, « it’s always night ».
Pas une année non plus sans un album de Circle juste au début de l’hiver. En bons Finlandais, ils ont la même discipline que leur Santa Claus. Les compagnons de routes connaissent ce quatuor infernal pour ses ineffables œuvres neo-kraut, post-folk, proto-zeppelinesque ou prometeo-heavy. S’il fallait désigner un groupe majeur de ce début de millénaire sur ce vieux continent, il ne fait aucun doute qu’ils arriveraient en pôle (sur un traîneau, encore bien !). Et les animaux surprennent, non pas en se transformant en carré, mais en larguant « Miljard », époustouflant double album où nos joyeux lurons réinventent la roue minimaliste. Abstraction faite musique, l’œuvre reste incroyablement humaine et résonnante. De quoi vous emmener jusqu’au bout de cet hiver qui tarde décidément à venir. They fly toward grace.
Enfin, parlons rééditions. « Enfin » est le mot qui convient pour aborder la mise à disposition du public de quatre cd’s de Coil, depuis longtemps indisponibles. Ces trente dernières années, la révolution électronique a pris d’assaut l’Iwo Jima musical afin d’y planter son drapeau. La victoire n’est (heureusement) pas totale, et les vrais héros (malheureusement) pas récompensés. Ca fait mal de penser que Coil a traîné sa musique sur vingt ans, sans que le public n’y fasse vraiment gaffe. Alors qu’Autechre, Labradford ou Nine Inch Nails ont admis leurs dettes, le groupe anglais est resté ignoré médiatiquement, honteusement rangé dans la case gothique à laquelle il n’appartient pas. Coil transcende la musique électronique, renvoie à l’ensemble de ses sous-genres et est derrière le catalogue le plus impressionnant de cette famille. S’il y a un seul génie – mot à utiliser avec parcimonie- dans les arts électroniques, c’est indubitablement de Coil qu’il s’agit. Peter Christopherson, ex-Throbbing Gristle, et Jhon Balance, ex-Psychic TV, sont bien les héros (presque) oubliés de ces 25 dernières années. Ca fait deux ans qu’on en reparle, que tout le monde se jette sur la moindre chose portant leurs noms : comme par hasard, il aura fallu la mort prématurée de Balance – pour une fois déséquilibré, il est tombé sur la tête. Grand malheur, parce qu’avec « The Ape of Naples », on les sentait sur le point d’amorcer une ultime métamorphose vers l’infiniment superbe. Hélas, mille fois, hélas. Mais voilà donc la réédition des indispensables « Musick to play in the dark » I et II. Mais voilà la première sortie en grands nombres des « tour only » « Remote Viewer » et « Black Antlers ». Tout ça avec des cd’s bonus composés d’inédits parfois stupéfiants. Plus personnes n’aura donc l’excuse de l’indisponibilité pour ignorer ces pépites de l’art alchimique coilien, cette plante qui mourrait sans cesse pour renaître sous une forme complètement unique et différente. En 2004, elle est morte pour de bon, mais gageons que de nombreuses abeilles l’auront butinée suffisamment pour que son esprit vive.
Côté live, je retiens avant tout la « Moog Ceremony » de Sunn à Bruxelles. Concert unique au line-up inédit. Pas une seule guitare en vue, mais bien trois Moog. Et les amis à la rescousse : Atsuo au gong et Julian Cope pour le chant. Un côté coilien en diable, une cérémonie dans laquelle le public s’est complètement perdu, guidé par le bout du nez et des oreilles vers un état presque catatonique.
Bonne année.
En guise d'au revoir
En cette période, j’imagine bien que tout le monde a mieux à faire que de lire des blogs. Moi-même, j’ai mieux à faire que le mettre à jour. Fausto s’envole dès ce mercredi vers de plus beaux horizons. Fermeture donc jusqu’au huit janvier. Que ceux qui veulent de la lecture ne s’inquiètent pas. Avant d’embarquer mes valises, je posterai mardi un petit bilan de l’année musicale.
Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez toujours lire une liste de “underrated writers” proposée par Syntax of things. Il y a des choix évidents, d’autres surprenants, et quelques noms qui ne sont pas “underrated” pour la bonne et simple raison qu’ils ne valent vraiment pas tripette.
Et si vous voulez toujours plus, les archives de tabula rasa vous attendent. Je vous suggère plus particulièrement:
- Cormac McCarthy, The Road
- Richard Powers, The Echo Maker
- Mark Danielewski, Only Revolutions
- Roberto Bolaño, Les détectives sauvages
- Thomas Pynchon, Against the day
Ca, c’est pour 2006. Pour ceux qui veulent regarder à la fois vers l’arrière et vers l’avant, je dis : lisez donc le tunnel de William Gass. En anglais dès maintenant, en français au printemps. Assurément, l’évènement de 2007 en littérature étrangère.
Joyeuses fêtes.
Rideau sur les mormons
Rudd n’a pas une adolescence facile. Son père est mort, sa mère est possessive et veut toujours le traîner à l’église, il est mal-aimé à l’école et peine à accepter son héritage mormon. En fouillant dans des vieux papiers, il trouve des lettres adressées à son paternel qui lui apprennent l’existence d’un fils illégitime. Prenant son courage à deux mains, il va à la rencontre de Lael.
En lui, Rudd se découvre un ami, le premier, le seul. Ils passent de plus en plus de temps ensemble à faire des choses pas nécessairement très intelligentes. A la même époque, pour un travail à l’école, Rudd tombe sur des articles de 1903 à propos d’un étrange meurtre rituel commis par le petit-fils d’un célèbre prêcheur mormon.
Je ne vais pas en dire plus sur l’intrigue : les ressorts utilisés par Brian Evenson dans « The open curtain » sont ceux du thriller, et je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir de lecture. De toute façon, il y a bien d’autres choses à dire tant l’auteur ne se contente pas de jouer sur le suspense.
Brian Evenson était un mormon jusqu’à ce qu’il demande son excommunication en 2000, processus personnel probablement influencé par la réaction de l’Eglise à son premier livre de fiction – jugé moralement répugnant, on avait demandé à l’auteur de « Atlmann’s tongue » de promettre d’arrêter d’écrire de tels livres ou de démissionner de son poste d’enseignant dans une université mormone. Dans « The open curtain », il s’intéresse à des crimes de sang commis par des membres aux franges de la communauté, crimes qu’il pense révélateur d’une tendance violente sous-jacente au mormonisme. Il fait ça sans aucune haine ou agressivité particulière envers cette religion, mais plutôt ave une volonté de la comprendre et de se comprendre lui-même.
Cette recherche, on la retrouve aussi chez Rudd. Déconnecté de ses racines, il va essayer de se reconstruire à travers son demi-frère et le récit du meurtre. Pour lui, l’échec sera malheureusement patent, mais pour le lecteur ce sera l’occasion de s’engager dans un puissante réflexion sur le secret, la famille, les traditions, la manière dont l’histoire de la communauté peut façonner une histoire personnelle.
Le plus impressionnant, à mon sens, dans « The open curtain », est la construction narrative, d’une très grande maîtrise. En fait, je trouve que la première partie est un peu lente, pas assez captivante stylistiquement. Par contre, la deuxième est superbe. C’est celle de la reconstruction post-traumatique, des amours adolescents déçus et de la descente progressive dans l’infamie et l’horreur. Un portrait psychologique très fin et superbement écrit. Je vous conseille de lire ça en écoutant les morceaux suggérés par Evenson – sa « playlist » est impeccable, mais c’est vraiment pour ces pages-ci qu’elle est parfaite.
Séduit par cette deuxième partie, on est finalement assommé par la dernière, long épilogue où le réel se voit « polluer » par le fantasme. Là, ça devient tout simplement brillant. Il n’est pas facile de mélanger réalité et hallucinations dans un même texte sans que ça paraisse creux ou artificiel. Evenson réalise ce tour de force stupéfiant : le lecteur lui-même perd ses repères et ne sait pas trop défaire le vrai du faux. Hagard, il est acheminé vers la conclusion sans avoir d’emprise sur l’expérience narrative qu’il est en train de vivre.
Le plus beau dans « The open curtain », c’est qu’on à ici un livre censé plaire à tous : amateurs de thrillers, de récits horrifiques ou de fiction littéraire y retrouveront leurs petits sans aucun problèmes et seront immanquablement fascinés par cette œuvre intense.
Brian Evenson, The open curtain, Coffe House Press, $14.95
Oh bonheur, la traduction française de ce livre paraît en janvier au Cherche-Midi, collection Lot49, sous le titre « Inversion ». 17€.
Fausto et les millions
Rat de bibliothèque
Après la course d’endurance « Against the Day », ma petite tête demandait un peu de repos. J’ai jeté un œil sur ce que j’avais en stock et mon choix s’est tout logiquement porté sur le volume le plus fin dans ma pile « à lire ». Par bonheur, si le livre est court et offre un certain repos par rapport à la machine pynchonienne, il est assez consistant pour pouvoir en faire un repas de qualité.
De repas, il en est d’ailleurs beaucoup question dans les aventures de Firmin, cet interlope métropolitain. Précisons tout de suite que notre héros est un rat, né par accident dans la cave d’une librairie d’occasion. Dernier d’une portée de treize, il n’arrive jamais à accéder à l’une des douze mamelles de sa mère. En attendant de pouvoir aller récupérer les dernières gouttes de lait laissées par ses goinfres de frères et sœurs, il dévore les volumes bon marché qui traînent au sous-sol. Et miracle : Firmin sait lire !
Les livres vont devenir le sel de sa vie. Il les dévore toujours, mais des yeux plutôt que des dents. Tous les ouvrages de la librairie y passeront, de la fiction – pauvre Firmin aura d’ailleurs bien du mal à la démêler de la réalité- au plus obscur livre de jardinage. Quand il ne lit pas, notre rat s’imagine rentrant en contact avec le propriétaire de son monde ou bien sort du magasin pour aller passer la soirée dans un cinéma qui passe du Fred Astaire puis du porno après minuit.
Son grand malheur est de ne pas savoir parler. Il voudrait tant raconter sa vie, discuter avec le libraire ou avec le très imbibé Jerry, auteur de science-fiction. Mais la parole lui est aussi inaccessible que Ginger Rogers sur l’écran de cinéma. Très déprimant pour lui (mais au fait, comment fait-il donc pour nous raconter sa vie ?).
« Firmin » est le premier roman de Sam Savage, soixante ans passé. Deux heures de plaisir garanti pour tous les lecteurs de ce petit livre bien écrit, intelligent, et surprenant. Lecture quasi-indispensable pour l’ensemble des membres de la confrérie des rongeurs de livres.
Sam Savage, Firmin, adventures of a metropolitan lowlife, Coffee House Press, $14.95
Against the day (3)
Venons-en au point le plus intéressant que j’ai vu soulevé jusqu’ici (merci Claro !) : Pynchon y décrirait la lutte des classes réelle du 20eme siècle. Non pas celle, mythologique, des prolos et des bourgeois, mais celle menée par les luddites contre la technologie meurtrière. Aborder « Against the day » par ce versant-là est potentiellement très fertile. Tellement que je n’aurai pas le temps de l’aborder ici de manière exhaustive.
Pour Pynchon, il ne faut pas entendre par luddite ennemi de la nouveauté scientifique (après tout, la machine détruite par Nedd Lud en 1779 est issue d’une technologie déjà vieille de deux siècles), mais bien une méfiance envers ce qui nous est présenté comme le progrès. Là est une des préoccupations principales de l’auteur : l’horreur du vingtième siècle – les camps d’extermination, la bombe atomique, les guerres où la majorité des victimes sont des civils- serait l’aboutissement du développement technique des siècles précédents. Devant ce fait, l’attitude saine serait de se méfier de ce que l’on nous présente avec beaucoup d’empressement comme une avancée pour l’humanité.
On notera qu’il y a quand même quelque chose d’ironique dans ce luddisme : si Pynchon est clairement à la gauche du spectre politique, c’est aussi de ce bord-là que l’on situe les « forces du progrès ». Le marxisme et le socialisme n’en n'ont pas contre la machine, mais bien contre la structure du capitalisme. Par ailleurs, les régimes qui mirent au point les processus industriels d’élimination des opposants et autres indésirables des années ’20 à ’50, sont tous historiquement liés d’une façon ou d’une autre au socialisme, et l’eugénisme coercitif –ce machinisme appliqué à l’homme- a été pratiqué pendant des années dans la Suède socdem.
« Against the day » se déroule à une époque où Nikola Tesla commence ses travaux sur l’électricité, qui le mèneront à essayer d’élaborer une arme surpuissante, le « death ray ». Le pouvoir de dévastation théorique de cet engin fait immanquablement penser à la bombe atomique. C’est aussi le temps du développement des chemins de fer partout dans le monde – et donc de l’opportunité d’envoyer des troupes ou des prisonniers dans les coins les plus reculés à des vitesses insoupçonnées. On voit aussi l’arrivée de véritables magnats à dimension globale – JP Morgan, par exemple- qui financent à peu près tout, de la recherche à l’effort de guerre de divers gouvernements.
La sympathie de Pynchon va clairement aux anarcho-luddites qui peuplent les pages du roman. Ils sont présentés dans une lumière positive, de lutte pour les droits de ouvriers, pour l’égalité, contre les gouvernements et le capital. Il est difficile d’ignorer les opinions politiques de l’écrivain. Ceci dit, on n’est pas dans le domaine du réalisme social, et rien n’est tout à fait noir pu tout à fait blanc.
De fait, il y a une pierre qui revient comme un refrain : le spath d’Islande. Sa particularité est d’offrir une double réfraction : lorsqu’on regarde un objet à travers ce calcite transparent, l’image est double. Tout acquiert une deuxième facette. Ainsi, si l’usage de la technique peut être mauvais, ceux qui veulent lutter contre cette situation doivent aussi l’utiliser, mais positivement. Rien n’est intrinsèquement mauvais ou bon.
Tous les personnages du roman ont également une dimension double, trouble. Les anarchistes vont au Casino et séjournent dans des villes d’eaux, les princesses fraient avec les prolos, les imposteurs sont nombreux, tout le monde est plus ou moins espion et on change d’allégeance plus souvent que de chemise. On voit aussi que la position de Pynchon par rapport à la violence anarchiste n’est pas aussi claire que certains voudraient le faire croire : à travers un artiste anar italien, il souligne les liens entre ce mouvement et le futurisme, dont on connaît les sympathies politiques.
Un seul personnage est unidimensionnel : Scarsdale Vibe, le méchant magnat, sorte de Morgan pynchonisé. C’est tout à fait regrettable et donne à « Against the day » une petite saveur de marxisme suranné. En effet, on voit qu’à l’état de simple ouvrier, les personnages sont relativement bons et que ce n’est qu’en sortant dans le monde que leur face sombre se révèle. La société corrompt, et il n’y a par conséquent que Vibe, qui règne au sommet, à être entièrement noir. Je ne devrais peut-être pas faire ce reproche : ce livre se devait quand même d’avoir son méchant cartoonesque, vu qu’il y avait déjà les formidables Chums of chance, délectable caricature d’un certain esprit boy-scout – tout du moins au début de leurs aventures.
« Against the day » a des défauts, mais, pour ma part, ils sont plutôt idéologiques et liés, non pas aux constats politiques – nationalisme, mercantilisme, fascination pour la technique, collusion entre gouvernements et grandes compagnies- que je partage partiellement, mais plutôt aux bribes de solutions proposées par certains personnages ou dans certaines recensions du livre. Elles ne sont pas explicitement de Pynchon et je pourrais être en train de me tromper complètement : est-il étonnant que des ouvrier de 1895 pensent comme… des ouvriers de 1895 ?
Littérairement, et c’est bien ça qui compte, le livre est un tour de force. Ce qui tient du tour de vieux singe qui tombe dans les gimmicks ou de la force créatrice d’un génie de l’art du roman sera dégagé dans les années à venir. Je me contenterais de dire que je ne me suis jamais ennuyé, que « Against the day » est narrativement palpitant, impeccablement écrit et remplit de moments de pur bonheur. Non, esprits chagrins, je n’ai pas vu de pages en trop ou de passages pompeux et indulgents.
Thomas Pynchon a choisi comme épigraphe une superbe phrase de Thelonious Monk : « It’s always night or we wouldn’t need light ». C’est un choix parfait: de la première page à la dernière, on bascule, émerveillé, entre la conviction que Pynchon nous amène un peu de lumière pour voir plus clair dans les brumes de notre temps et celle qu’il nous faudrait bien une petite torche pour démêler l’écheveau de niveaux de lecture, le puzzle linguistique, la symphonie polyphonique et polysémique qu’il nous soumet. A vous de jouer !
Thomas Pynchon, Against the day, Penguin Press, $35.00
Against the day (2)
Lire d'abord la première partie, si ce n'est déjà fait.
« Against the day », le résumé de tout ce qu’il a fait ? On rejoint le paragraphe précédent et on revient à cette première phrase polysémique en diable – vous pouvez être certains qu’elle va faire débat encore longtemps. S’agit-il de larguer les amarres pour de bon, de reprendre un part un tous les thèmes précédents, de s’expliquer, de prendre de la distance ? Allez, allez, rajouter ce que vous y voyez, on n’a pas fini journée. Sinon, on notera que, effectivement, tout ce qu’on aime chez le Pynch est là : le ukulélé, les chansons, les orgies, les pratiques sexuelles étranges, les stupéfiants, les sociétés secrètes, les conspirations… Et puis surtout cette prose magique, ces moments de pure poésie, ces instants où l’on retire les yeux de la page pour se rendre compte qu’on lévite de plaisir, à deux mètres du sol. On se dit alors : « pourvu que ça ne s’arrête pas ». Il y a, dans ces 1085 pages, matériel à quelques énormes orgasmes littéraires, je vous l’assure –et vous savez comme moi que ce genre de plaisir est puissant, donc rare.
Un roman post 9/11, une attaque contre l’Amérique de Bush. Soyons de bon compte : lorsqu’on nous parle d’un « evil halfwit » à Washington, le lien se fait automatiquement. De plus, il est largement question de terrorisme – ici, anarchiste et américain, vu, comme c’est étrange, comme criminel en haut lieu et résistance sur le terrain. Oui, Pynchon nous parle aussi du monde actuel. Mais il l’a fait dans tous ses romans et je le vois mal avoir une opinion positive sur un président quel qu’il soit. Ce me semble être un aspect plutôt mineur de l’œuvre. A explorer, toutefois.
--------------------
La troisième et dernière partie de ce papier viendra demain. Désolé de ne poster qu'une partie aussi courte ce soir, mais il ne m'est pas possible de procéder autrement.
En attendant, de nombreux autres posts sur Pynchon sont disponibles dans les archives.
Against the day (1)
Par où commencer ? C’est là la deuxième question que je me pose. Pas facile de savoir dans quel sens prendre ce machin et de quelle façon lui rendre justice. Une idée comme une autre est de jeter un œil sur ce qui semble revenir souvent dans les innombrables comptes-rendus critiques ( ?) déjà publiés. Je ne m’attarderai pas sur les reproches type « les personnages n’ont aucune profondeur » ou « ce n’est pas crédible ». Ils ne peuvent venir que de gens qui n’ont lu aucun autre Pynchon ou qui soutiennent le contraire tout en ayant apparemment complètement oublié leurs lectures précédentes
Ca ne vaut pas « Gravity’s rainbow ». Outre le problème de temps écoulé entre l’ingurgitation et le jugement – pas assez pour la digestion-, ce genre d’affirmation me pose problème et me semble tout simplement stupide. Pynchon n’a écrit que des bons livres, mais il n’a probablement écrit qu’un seul chef-d’œuvre absolu, un monument de l’histoire littéraire mondiale : ce fameux arc-en-ciel qui a donné un superbe éclairage paranoïaque à la littérature du 20eme. Juger ses autres romans à l’aune de son monstre de mots, c’est jeter au bac tous les écrits de Cervantes à cause du Quichotte, c’est envoyer bouler « Laugther in the dark » à cause de « Lolita ». En somme, c’est exiger l’impossible d’un auteur qui a déjà bien donné et refuser de s’attaquer à un livre unique et particulier parce un autre lui fait de l’ombre avant même qu’on ne l’ouvre. C’est l’argument facile pour le paresseux et le pisse-copie.
C’est le meilleur après « Gravity’s rainbow ». Une variation sur le thème précédent. On a deux choses ici. Premièrement, et une fois de plus, « GR » comme étalon. Que l’opinion retirée de cette mesure soit positive ou négative, ça reste idiot, ou en tous cas, ça marque une impossibilité à envisager « Against the day » comme une œuvre à part entière. C’est un raisonnement qui marque, chez celui qui le tient, une mentalité de comptable – le meilleur depuis 33 ans, à ne pas manquer !-, plutôt que de lecteur avec une certaine exigence. Deuxièmement, les livres, c’est comme les cd’s : le dernier est toujours le meilleur, jusqu’au moment où il y a un sommet véritable. Alors, chaque « item » suivant devient le nouveau meilleur depuis le vrai meilleur de tous les temps. J’imagine que c’est une façon de penser qui a le mérite d’être rassurante.
C’est le plus accessible (sous-entendu : donc celui que vous devez lire en premier). L’inaccessibilité supposée d’une œuvre n’est pas un argument qui me fait me jeter sur un bouquin comme une mouche sur une merde, mais je ne saisis pas non plus pourquoi l’accessibilité serait un critère pertinent. Enfin, soit. Personnellement, celui dans lequel je suis rentré le plus facilement, c’est « Mason & Dixon ». Coquin de sort : l’action se déroule au 18eme et la langue suit. Le plus court, c’est « The crying of lot 49 », mais putain il y a moyen de s’y perdre dans ces 190 pages. « V. », c’est chouette aussi. Malheureusement, pour suivre et retenir les significations de cette fameuse lettre, il vous faudra un impressionnant carnet moleskine et un très bon crayon. J’ai souvent lu que « Vineland » était le plus simple. Ouais. Si vous avez une bonne connaissance de la télévision US et de la contre-culture californienne, pas de problèmes… Le plus abscond serait « Gravity’s rainbow ». A voir le succès qu’il a rencontré à sa sortie, il a plutôt défini une époque et su capter la façon de pensée de quelques millions de personnes. Ceux-là ont sans doute sués, mais de là dire que c’est « too much »… En fait, le plus accessible, c’est celui dans lequel on se lance et parvient à s’accrocher. Il n’y a pas qu’une seule porte d’entrée dans cette maison de fou. Il faut du courage, un bon dico, une connexion internet, et je vous jure : ça ira. Alors, si vous voulez commencer par « Against the day », par Dieu : n’hésitez pas. Mais n’y venez pas en pensant que 1085 pages de prose pynchonienne équivalent à « a stroll in the park ».
--------------------
La deuxième partie de ce papier viendra d'ici à vendredi.
En attendant, de nombreux autres posts sur Pynchon sont disponibles dans les archives.
Il fut un temps...
...où un gros éditeur n’hésitait pas à publier un travail plutôt académique sur le roman américain. Ces livres n’étaient destinés qu’à un public relativement confidentiel, et pourtant, des maisons comme Grasset ou Le Seuil s’en occupaient.
Je lisais récemment « Les USA, à la recherche de leur identité », livre de Pierre Dommergues paru en 1967 chez Grasset. Il s’agit d’une compilation de propos d’une bonne partie des auteurs majeurs de l’époque. Norman Mailer sur la politique. Saul Bellow et la sensibilité juive. Le combat noir par Ralph Ellison ou LeRoi Jones. Ginsberg sur la poésie. Le théâtre par Arthur Miller et Edward Albee. Et aussi John Barth, William Burroughs, Philip Roth, Joseph Heller… Plus j’y pense, plus ça me semble dingue. A une époque où internet n’existait pas, ce livre était une sorte de don du ciel : près de 500 pages d’auteurs rares s’exprimant sur leur art et sur leurs contemporains. Quarante ans plus tard, c’est toujours une mine d’information bien utile.
C’est le genre de livre que l’on ne trouve plus qu’au détour d’une brocante ou dans les rayonnages poussiéreux d’un bon libraire d’occasion. Dans mes propres rayonnages que j’essaie de garder plus ou moins propres, j’ai d’autres ouvrages de ce type. « La grand-route, espace et écriture en Amérique » de Pierre-Yves Pétillon, paru au Seuil en 1979, est une cartographie du voyage littéraire américain, de Irving à « Gravity’s Rainbow ». Indispensable, mais malheureusement indisponible depuis longtemps. Toujours chez Seuil, il y a « Au-delà du soupçon », de Marc Chénetier (1989). Une étude sur les nouveaux écrivains US depuis 1960. En fait, le denier livre de ce type publié par une des grosses maisons doit être « Histoire de la littérature américaine, 1939-1989 » de Pétillon, dont on attend désespérément la suite.
Il est bien sûr toujours possible de trouver des essais intéressants chez de plus petits éditeurs. Plutôt cocasse : jusqu’à ce que Christian Bourgois réédite « Gothique Charpentier » de William Gaddis, on pouvait trouver des études entières consacrées au roman chez Didier, Ellipses et Houdiard alors que le texte lui-même n’était plus disponible depuis des années.
Le même problème se pose avec les traductions. L’édition française est très satisfaite lorsqu’elle compare son bilan dans ce domaine avec celui des maisons américaines. Il y a sans doute de quoi. Il n’y a pourtant pas de quoi pavoiser : il est impossible de trouver un édition autre que pour enfant des « Aventures de Tom Sawyer » -dont je vous ai déjà dit tout le mal qu’il faut en penser-, on laisse, sans honte, « L’arc-en-ciel de la gravité », « JR » ou « Les aventures d’Augie March » épuisés, indisponibles.
Dans « La condition littéraire », Bernard Lahire considérerait le livre comme une industrie guidée par l’offre. L’édifice repose entièrement sur l’auteur et sur son bon plaisir. Il est peu probable que moins de spécialistes et de passionnés ne veulent écrire des ouvrages savants que cela se faisait il y a encore vingt ans. Il faut donc regarder du côté des éditeurs.
Pourquoi donc les maisons grand public se sont désintéressées de ce type de publication ? L’explication paraît évidente : ça ne se vend pas – ou ça se vend trop peu. Mais trouvait-on plus d’acheteurs il y a vingt ans ? Ca ne me semble pas clair. Si l’on accepte que la volonté d’écrire est toujours là et que les acquéreurs ne sont pas moins nombreux que précédemment, il ne reste plus qu’à conclure que ce sont les éditeurs eux-mêmes qui ont tourné casaque.
Ce n’est pas tant que la littérature de qualité ne fait plus recette ou que l’analyse littéraire n’intéresse plus personne : c’est surtout que certains éditeurs prennent le lecteur pour un con qu’il ne faut pas trop bousculer. A ce titre, je préfère mille fois un Patrick Le Lay qui indique clairement que sa chaîne télé à pour vocation de vendre les produits des annonceurs à un comité d’édition frileux mené par une poule mouillée qui prétend ne pas avoir le choix.
On ne peut pas espérer vendre ce que l’on ne fait même pas imprimer. On ne saurait pas déterminer ce que le bon peuple veut lire par une enquête marketing. L’immense majorité de livres ne se vendent pas assez pour être rentables et les bénéfices sont faits par une poignée d’ouvrages. Pourtant, on publie plus chaque année. Si l’on choisit de privilégier un ouvrage de merde qui ne trouvera pas acquéreur plutôt qu’un de qualité qui fera le bonheur d’une poignée, ce n’est ni la faute du marché, ni la faute du lecteur. C’est une question de responsabilité personnelle, voir d’honneur : Olivier Nora, Denis Jeambar et autres Francis Esmenard, prouvez que vous n’êtes pas encore complètement étrangers à l’art…
Le dit du Pynch
« Unlike sound or light or one of them, news travel at queer velocities and not usually even in straight lines. » (p. 313)
« “I wish I were not here (…) I wish I had never seen these Halls of Night, that I were not cursed to return and return. You have been so easy to fool –most of you anyway- you are such simpletons at the fair, gawking at your Wonders of Science, expecting as your entitlement all the Blessings of Progress, it is your faith, your pathetic balloon-boy faith” » (p. 555)
« Reader, she bit him. » (p. 666)
« Hundreds, by now thousands, of narratives, all equally valid – what can this mean? » (p. 682)
« “Those poor innocents (…), back at the beginning of this… they must have been boys, so much like us… They knew they were standing before a great chasm nine could see the bottom of. But they launched themselves into it anyway. Cheering and laughing. It was their own grand ‘Adventure’. They were juvenile heroes of a World-Narrative – unreflective and free, they went on hurling themselves into those depths by tens of thousands until one day they awoke, those who were still alive, and instead of finding themselves posed nobly against some dramatic moral geography, they were down cringing in a mud trench swarming with rats and smelling of shit and death.” » (p. 1023-1024)
« “Gentlemen”
« May we imagine for them a vector, passing through the invisible, the “imaginary”, the unimaginable, carrying them safely into this postwar Paris where the taxis, battered veterans of the mythic Marne, now carry only lovers and cheerful drunks, and music which cannot be marched to goes on uninterrupted all night, in the bars and bals musettes for the dancers who will always be there, and the nights will be dark enough for whatever visions must transpire across them, no longer to be broken into by light displaced from Hell, and the difficulties they find are no more productive of evil than the opening and closing of too many doors, or of too few. A vector through the night into a morning of hosed pavements, birds heard everywhere but unseen, bakery smells, filtered green light, a courtyard still in shade… » (p. 1082-1083)
« They fly toward grace. » (p. 1085)
Un sérieux prétendant
En 1967, John Barth publie « The literature of exhaustion », où il aborde la mort du roman et voit une piste de renouvellement dans le recyclage littéraire des formes et textes anciens. C’est ce qu’il fera tout au long de sa carrière, avec notamment Sinbad, les milles et un nuits, ou encore la guerre de Troie.
Près de 40 ans plus tard, Ben Ehrenreich recycle l’Odyssée de manière très convaincante. C’est une vrai réappropriation : il n’a pas la fausse bonne idée de réécrire l’histoire en changeant le cadre, les noms, le vocabulaire. Il préfère prendre le ressort narratif, le faire sien et en sortir un texte qui lui est propre, renvoyant à Homère sans afficher un respect qui serait paralysant.
Payne meets Penny. Ils tombent amoureux, s’achètent un billet de bus, destination le plus loin possible. Une fois arrivés, Payne construit une maison, colonise la région, enrôle quelques misérables hères vivant dans le coin et part à l’attaque des voisins, tuant, pillant, volant, s’enrichissant. Jamais repu, il se laisse embarquer dans une guerre indéterminée, lointaine et interminable, laissant derrière lui une Penny enceinte, entourée de courtisans qui s’enhardissent avec les années.
Ehrenreich laisse entrevoir de très belles choses. Une voix et un style propre, une capacité à s’attaquer sans complexe à des choses plutôt difficile – que ce soit Homère, le pouvoir, l’amour- sans que ce soit bateau, et une maîtrise technique lui permettant de jongler avec les types de narrations d’une façon harmonieuse – tour à tour récit épistolaire, assemblage de témoignages écrits à la première personne ou fiction classique avec narrateur omniscient.
J’ai beaucoup apprécié les moments de repas dans la demeure Penny. La meilleure scène de ce type est sans doute celle où les prétendants, ayant entendu une rumeur qui disait Payne mort, se lancèrent dans un spectacle odieux devant la « veuve », chaque plat, chaque discours une occasion de célébrer la mort de l’époux. Les personnages et les plats sont décrits avec une verve qui fait penser à un Pynchon qui aurait –malheureusement, tout de même- garder le sens des proportions – orgie et chansons incluses.
Tout n’est pas parfait : dans la première partie, par exemple, Ehrenreich s’étend avec une certain pesanteur sur les procédés de conquête de Payne afin sans doute de faire saisir au lecteur un parallèle avec une certaine administration actuelle. C’est pataud et convenu – il n’est pas nécessaire de souligner à gros traits ce qui semble évident.
Ceci étant, « The Suitors » est un premier roman tout à fait remarquable qui permet à son auteur de s’affirmer comme un des prétendants à la relève littéraire américaine. En tout cas, une belle preuve du dynamisme des écrivains de ce pays.
Ben Ehrenreich, The suitors, Counterpoint, $23.00
Quarterly Conversation
Là-bas et chez nous: litblogs
La blogosphère littéraire américaine est absolument épatante. Il y a moyen de se perdre pendant des heures dans cette myriade de sites où chaque blogger a un ton, un style particulier et surtout une passion contagieuse pour les livres. Chez les meilleurs d’entre eux, on peut voir la promesse d’un renouvellement de la critique, d’un nivellement vers le haut par rapport aux médias traditionnels, sérieusement en perte de vitesse.
La couverture de la publication du nouveau roman de Thomas Pynchon est « a case in point », comme on dirait là-bas. A de rares exceptions près, les comptes-rendus, positifs ou négatifs, parus dans les médias traditionnels sont nuls à chier. Vraiment. C’est tout à fait compréhensible : Pynchon n’est pas un auteur facile, « Against the day » est une brique de 1085 pages… Il y aurait tout de même eu moyen de faire un effort. Non : ces papiers sont une longue liste de clichés, de lieux communs, de reproches à côté de la plaque. Désespérant. Par contre, les bloggers ont pris la voie de la sagesse. Pas de jugement –dans un sens comme dans l’autre- à l’emporte-pièce, une vraie retenue –une œuvre comme celle-là ne s’apprécie pas via une lecture rapide ou après une période de réflexion de deux jours-, le souci d’éviter le cliché – peu de papier commençant par la fameuse antienne « Pynchon-le-reclus »- et une meilleure mise en perspective des tenants et aboutissants de « Against the day », mis en rapport avec les cinq romans le précédant. Certes, ça tient du format. On a à la fois plus de temps et plus de place sur un blog. Mais ça n’explique pas tout. Les critiques professionnels sont bien souvent des pisse-copies ayant oubliés à peu près tout de la passion qui les a amenés là où ils sont. On trouve chez leur nemesis online un idéalisme qui fait plaisir à lire.
Chez les pros, certains se sentent visiblement menacés. Pour preuve, cet article de Rachel Cooke pour l’Observer. C’est un papier absolument pathétique, mélangeant les affirmations grotesques –un bon critique est chose rare, c’est pourquoi il faut payer pour le lire-, les raccourcis les plus stupides – les blogs sont populistes- et les mensonges les plus éhontés –j’ai passé la journée à chercher, je n’ai rien trouvé de bon (en ce qui me concerne, une demi-journée m’a suffit à dégoter une quinzaine de blogs qui me satisfont plus que le supplément culturel de l’Observer). Un assaut de ce niveau d’idiotie ne vient que de la part d’une personne aux abois. Mutadis mutandis, Cooke me fait penser a des marchands de chandelles qui lanceraient une pétition contre la concurrence déloyale du soleil – la lumière est un chose précieuse, c’est pourquoi il faut payer pour en bénéficier.
Heureusement, il y a des gens plus clairvoyants. Je pense notamment à Frank Wilson, responsable des pages livres du Philadelphia Inquirer, qui engage des bloggers qu’il apprécie pour écrire une critique de temps à autres. Pourquoi se priver, en effet, d’une telle mine d’or ?
Par comparaison, la blogosphère littéraire francophone est résolument à la traîne. Il y a moins de sites, et la qualité est plus difficile à trouver. Je ne pense pas qu’on verra naître d’ici peu une polémique à la Cooke ou une démarche à la Wilson dans nos vertes contrées. Ceci dit, il y a, apparemment, un léger intérêt de la presse papier : Alexandra du Buzz littéraire aurait été interviewé par deux magazines de renom – dont Technikart. Son site est bien tenu, dynamique, et, j’imagine, fort lu. Malheureusement, la plupart des auteurs dont on y parle me paraissent tout sauf essentiels. C’est peut-être bien là le problème des blogs francophones : notre littérature n’est franchement pas au mieux de sa forme, mais il semblerait qu’on s’en contente –et quand on regarde ailleurs, c’est souvent vers des écrivains pas plus intéressants. Pendant ce temps, aux USA, non seulement la plupart des bons blogs accordent une place important à la littérature en traduction, mais il y en a même qui s’y consacrent presque entièrement.
Saluons tout de même les efforts de Pugnax, Scarecrow, Stalker ou encore Mille-feuilles. Il ne reste plus qu’à espérer que cette différence transatlantique est à mettre sur le dos du jetlag technologique dont les européens sont souvent victimes. A réévaluer dans six mois, donc.
Tout est dit
Charles D’Ambrosio, The dead fish museum, Knopf, $22.00
Nouvelles du Pynch (3)
« “Looks, there’s West Ham !”
“There’s the park, and Upton Lane !”
“There’s a number of lads all in claret in blue!”
“Kicking something back and forth!” »
Il est physiquement impossible de voir jusqu’à l’East End et Upton Park depuis Earl’s Court. L’équipe de football la plus proche est en fait Chelsea. Pynchon choisit pourtant West Ham. Les lecteurs de ce blog connaissent déjà la passion irrationnelle que j’ai pour les Hammers. Ergo, cet extrait n’a aucun sens si l’on ne comprend pas que c’est à moi que l’auteur s’adresse. A la lecture, je me suis levé de ma chaise, ai serré les poings, et crié « Yesssss ! » d’une voix à la fois stridente et masculine. Comme Hayden Mullins quand il a marqué le week-end dernier.
Plus sérieusement, on peut effectivement se demander pourquoi le Pynch choisit cette équipe, qui n’est pas la plus connue des équipes londonienne, ni aujourd’hui, ni alors. Au départ (1895), le club s’appelle Thames Ironworks, du nom des ateliers de construction navale dirigés par le fondateur du club – et où les joueurs travaillaient. On y fabriquait des bateaux de guerre. Il y a, dans « Against the day », beaucoup d’ouvriers et même un bateau de guerre – certes d’un genre bizarre. C’est un peu ténu, comme lien. Je crois que je vais donc rêver cette nuit de Thomas Pynchon, une écharpe « claret and blue » autour du cou, soutenant les Hammers demain contre Everton.
Up the Irons !
Un mur contre le peuple de papier
Né en 1976 à Guadalajara, Plascencia est arrivé à El Monte, Californie, à l’âge de huit ans. Il ne parlait pas un mot d’anglais. Vingt-deux ans plus tard, le voilà doctorant en littérature et surtout auteur de « The people of paper », un remarquable premier roman. Refusé par toutes les grandes maisons, c’est McSweeney’s qui a décidé de l’éditer aux USA. Grâce soit rendue à Dave Eggers.
Il n’est pas simple de faire justice à ce livre. C’est un récit mythologique abordant à la fois la création de l’espèce humaine, l’immigration mexicaine, l’amour déçu, la difficulté d’écrire et une étrange guerre entre un homme qui mouille son lit et l’omnisciente Saturne. Le tour de force est de rendre cet ensemble cohérent et facile d’accès, sans jamais être simpliste ni en paraître prétentieux.
Plascencia a un véritable sens poétique, une grande sensibilité, une imagination débridée et un sens de l’humour et de la dérision irrésistible. En cela, il fait penser à un George Saunders débarrasser des scories politiques et doté d’une plume plus chantante – si ça veut dire quelque chose… Par ailleurs, une large partie du livre s’intéresse au rapport entre l’écrivain et sa création à travers l’intervention directe de l’auteur comme protagoniste de son récit, opposé à la lutte de ses personnages pour leur liberté. C’est un thème classique, mais il est exceptionnel de voir à quel point il arrive à faire passer le message d’une façon légère et profonde. C’est une discussion post-moderne qui serait amusante pour n’importe quel lecteur. Chapeau bas.
Terminons par une autre grande qualité de ce livre : sa mise en page, de prime abord chaotique. Trop souvent, on se met à jouer avec la forme pour faire bien et cacher le vide de la narration. Rien de cela ici : Plascencia trouve à chaque chapitre la forme idoine pour accrocher le lecteur et coller au sens du texte. Tout cela nous donne un livre qui est à la fois un bel objet, une remarquable réflexion philosophique et une superbe histoire sur l’amour et la place de l’homme dans l’univers. Je vous assure que les personnages vont rester en vous et ressortir quand vous ne vous y attendrez pas…
Voilà un premier roman qui mérite tous les applaudissements et introduit un auteur dont on peut espérer les plus belles choses dans les années à venir. Puisque Dubya s’est paraît-il mis à lire, « People of paper » est un livre que Laura devrait lui offrir pour Noël…
Salavador Plascencia, « The people of paper », Bloomsbury, £14.99
Nouvelles du Pynch (2)
Lire « Against the day » est une expérience qui exige du lecteur plus de temps qu’un roman ordinaire. Pas seulement parce que c’est évidemment plus complexe et plus profond que la majorité des titres publiés cette année, mais surtout parce que la prose de Pynchon est un plaisir permanent qui arrête le regard, qui force à lire et à relire certains passages et puis à s’arrêter quelques instants pour y penser. C’est donc relativement fatigant, et ça bouleverse quelque peu mon rythme habituel.
En général, je lis dans le bus jusqu’au travail, en marchant entre l’arrêt et le bureau, pendant l’heure de table et puis de nouveau dans le bus sur le chemin du retour. Une fois à la maison, si je n’ai rien d’autre de prévu, c’est reparti pour trois heures de lecture. Ce régime est impossible à maintenir avec AtD, que je ne peux lire qu’assis confortablement avec un dictionnaire et une connexion internet à portée de main. Voilà pourquoi je prends un autre livre avec moi au boulot, quelque chose de plus léger, plus reposant. J’ai donc commencé « The joke’s over », mémoires du fameux illustrateur Ralph Steadman concernant sa relation de travail avec Hunter S. Thompson.
Hier, je suis tombé sur le récit de leur première collaboration à l’occasion du Kentucky Derby. Gallois jamais sorti de son pays, Steadman va se rendre compte avec horreur qu’il est impossible de dessiner le portrait d’un américain et de le présenter ensuite au modèle : il va prendre très, très mal la caricature. Le dessinateur de s’exclamer « it took me quite a while (…) to realize that Kentuckians (…) take things like that as a personal comment and even, in some cases, an insult, comparable to a smack in the mouth ».
A la lecture de ce passage, je me suis demandé quelle pourrait bien être la vision américaine de ce genre de malentendu. Et j’ai tout d’un coup réalisé que Thomas Pynchon me l’avait donnée en page 224, deux heures auparavant.
« On this island, as you will have begun to notice, no one ever speaks plainly. (…) Any who may come to feel betrayed by them, insulted, even hurt, even grievously, are simply ‘taking it too seriously’ The English exercise their eyebrows and smile and tell you it’s ‘irony’ or ‘a bit of fun’, for it’s only a combination of letters after all, isn’t it. »
On parle ici de langue, et Steadman de dessin, mais on parle surtout de tournure d’esprit, de façon de penser. Mis en regard, les deux passages se font écho, comme deux points de vue radicalement différents sur une même scène. Le hasard ( ?) fait bien les choses.
Un tunnel de mots
Comment parler d’un tel livre ? Comment ne pas faire insulte à la prose splendidement étalée sur 651 pages ? Faut-il oser taper des mots à la suite de ces mots lus, avec la certitude de passer pour un couillon qui aurait mieux fait de la fermer et de garder ses yeux bien fixés sur le volume ? Pas le choix, il est trop tard pour reculer…
« The Tunnel » est un livre épuisant, pénible, exigeant, difficile, dans le fond comme dans la forme. C’est aussi un livre splendide, fascinant, courageux, admirable. Un sommet. William Frederick Kohler, professeur d’histoire d’une cinquantaine d’années, vient de terminer le manuscrit de l’étude de toute une vie, « Guilt and innocence in Hitler’s Germany » et tente d’en écrire l’introduction. Peut-être paralysé par la perspective de mettre ainsi une note finale à son grand œuvre, il bloque et écrit à la place sa propre histoire.
Maudissant une existence passée sur une chaise ou sur le trône à être victime du « fascisme du cœur », Kohler ressasse les épisodes de sa vie. Les heures à être dans les bras et surtout dans le con de son ex-maîtresse, sa vie d’enfant avec une mère alcoolique et un père autoritaire et raciste, sans amis, développant déjà d’étranges passions, son parcours universitaire, son rôle de pater familias. Il trouve une sorte d’équilibre lorsqu’il se met à creuser un tunnel dans la cave, dissimulant son œuvre à sa femme, comme il lui cache son excavation mentale en mélangeant les pages de son autoportrait et celles de son œuvre académique.
Kohler est un être détestable, répugnant. Marié à Martha, cette femme qui ne veut plus écarter les cuisses, il ne sait pas s’il la hait ou s’il se fout d’elle. Ensemble, ils ont eu deux enfants avec qui il n’a aucune relation – il y en a même un dont il refuse de prononcer le prénom. A l’université, il est entouré de collègues à moitié fous, qui lui reprochent d’essayer perpétuellement de mettre la main dans les culottes de ses étudiantes en échange de bonnes notes. Ceux qui assistent à ses cours le traitent régulièrement de nazi – et il faut dire que le bon professeur n’aime pas vraiment les juifs et ressent une étrange empathie pour les dirigeants du NSDAP.
On travaille ici dans l’ordure, dans le scatologique, dans l’hypersexué. Tout est en place pour faire une œuvre repoussante. Et c’est là que le miracle de l’écriture opère. William H. Gass a creusé un tunnel à même le langage, une descente dans les profondeurs du verbe, un travail inouï pour en sortir la prose la plus pure, le style le plus parfait, le plus original imaginable. C’est une petite musique qu’on entend en lisant, une mélodie, quelque chose d’indescriptible. Il y a le rythme, le son, la poésie, il y a les mots, leurs enchaînements, les phrases, les paragraphes, et ils sont presque tous parfaits.
C’est peut-être la dernière œuvre majeure du vingtième siècle, et c’est sans doute aussi la plus facilement haïssable. Il est compliqué de ne pas être dérangé par la personnalité de Kohler, mais il me semble impossible de ne pas être fasciné par cette écriture, cette composition, cette architecture narrative d’un modernisme stupéfiant. Et finalement, c’est peut-être ça qui a provoqué le rejet de certains : si le narrateur est aussi détestable, il est scandaleux que la prose magnifie son propos et que l’auteur ne le rejette pas ouvertement. C’est l’erreur commise en 1955 au sujet de Humbert Humbert. Tant pis pour les censeurs : la littérature n’est pas toujours pour les cœurs sensibles, et « The tunnel » est une saisissante œuvre d’Art qui bouleversera celui qui aura le courage de s’y plonger.
William H. Gass, The Tunnel, Dalkey Archive, $15.95
Le Cherche-midi publiera en 2007 la traduction de Christophe Claro dans la collection Lot49. Je suis très curieux de voir comment le côté politiquement incorrect du texte va être accueilli en France.
Nouvelles du Pynch
Il est enfin entre mes mains ! Il va falloir du temps pour en arriver à bout, mais jusqu’ici c’est un vrai plaisir. Ah, retrouver la prose de Pynchon !
Juste une petite remarque en passant. Les premières pages de « Against the day » se déroulent à Chicago, ville d’où vient Augie March, le célèbre personnage de Saul Bellow. La première ligne de cette œuvre est rentrée dans l’histoire littéraire – il faut dire qu’elle est superbe :
“I am an American, Chicago born—Chicago, that somber city—and go at things as I have taught myself, free-style, and will make the record in my own way: first to knock, first admitted; sometimes an innocent knock, sometimes a not so innocent. But a man’s character is his fate…”
Chicago, that somber city. Ou comment décrire une ville en un seul mot. Un mot parfait dans une phrase parfaite.
A la page 41 de « Against the Day », Pynchon décrit
“Out the window in the distance, contradicting the prairie, a mirage of downtown Chicago ascended to a kind of lurid acropolis, its light as if from nightly immolation warped to the red end of the spectrum, smoldering as if always just about to explode into open flames.”
C’est du Pynchon au sommet de sa forme, c’est aussi le genre de passage que détestent ceux qui ne l’aiment pas. Le mot de Bellow est plus puissant, mais la phrase de Pynchon est infiniment plus belle. Lurid, somber, deux mots qui semblent s’opposer, mais qui décrivent la même réalité. J’adore le Pynch’ quand il permet au cortex de trouver des connexions de ce type. Encore, encore ! J’en demande encore plus !
Le mythe du reclus
Il est impossible de ne pas s’être rendu compte qu’un nouveau Pynchon vient de sortir. Des articles paraissent partout, du NY Times au plus modeste des blogs (celui-ci, par exemple). Et avec ce foisonnement de papiers, toujours ce lancinant refrain, cette ritournelle à laquelle il est impossible d’échapper : Pynchon, l’écrivain reclus. Mais est-ce vraiment un qualificatif pertinent ?
Le journaliste paresseux à l’habitude de comparer le Pynch’ avec Salinger – un rumeur disant qu’il s’agissait du même homme a d’ailleurs circulé. Certes, au niveau littéraire, il n’y a pas photo. Par contre, au niveau de l’isolement, il paraît que c’est kif kif bourricot. Le père de Holden Caulfield n’a pas fait une seule apparition publique depuis 1965, à peu près à l’époque de son divorce, et après dix ans de retrait progressif d’un grand monde qu’il fréquentait pourtant avec assiduité. Dans les années ’90, Ian Hamilton décide d’écrire une biographie de Salinger. Apprenant la nouvelle, l’auteur lance des poursuites contre son biographe : hors de question d’écrire un tel livre. Finalement, il sortira quand même sous le titre « A la recherche de JD Salinger », portrait sans complaisance d’un homme presque mentalement malade, réfugié derrière les murs de sa propriété, n’y laissant rentrer que l’une ou l’autre personne, au gré de ses lubies. Quelques années plus tard, Margaret, sa propre fille, publiera son témoignage, radicalement différent : il y est décrit comme un globe-trotter, bon vivant, parfaitement équilibré. La vérité est sans doute quelque part entre les deux.
Et Pynchon là dedans ? On a vraiment entendu tout et n’importe quoi. Il a été tout à tour Salinger donc, sympathisant des Davidiens, Wanda Tinasky ou encore le UNA Bomber. La dernière photo certifiée date de 1957, il n’a pas plus accordé d’interviews qu’il n’a été vu lors des remises de récompenses qui lui ont été attribuées. Ajoutons à ça une œuvre où la paranoïa et la clandestinité figurent en bonne place, et il faut bien admettre que tous les ingrédients sont en place pour en faire l’America’s most reclusive writer. Et pourtant…
Personne ne lui a encore consacré de biographie (bonne chance au volontaire !), mais lorsque un sitcom américain base un de ses épisodes sur une rencontre avec Pynchon et fait parvenir le script à son agent, ce n’est pas un avocat qu’on envoie, mais bien une réponse enthousiaste de l’écrivain. Il demandera tout de même des changements : certains détails du script ne lui correspondent pas assez !
Par ailleurs, certains détaillent glanés à droite et à gauche cadrent mal avec cette notion de reclus : on parle de lui fumant des joints avec Brian Wilson, il écrit sur les émeutes de Watts, rencontre Salman Rushdie, dîne avec Ian McEwan lorsqu’il est de passage à New York, assiste à la remise de diplôme de sa nièce, conduit son fils à l’école. En 2004, il accepte le scénario d’un épisode des Simpsons où il est censé faire une apparition et se rend en studio pour enregistrer lui-même le texte. Au vu du texte qu’il a sanctionné, je pense que tout doute sur son attitude envers sa réputation s’évapore : il en rigole bien de cette bonne blague.
C’est d’ailleurs tellement simple de trouver Pynchon quand on le cherche qu’il n’aura fallu que quelques jours à une équipe de CNN pour le filmer se promenant à NY. Et c’est à cette occasion là qu’est sans doute tombé l’élément qui permet le mieux de comprendre ce qu’il faut penser de ce terme de reclus. Furieux d’avoir été surpris, il contacte la chaîne, demandant à ne pas être identifié à l’antenne. On lui demande son avis sur la réputation qu’il a. La réponse est claire : "My belief is that 'recluse' is a code word generated by journalists ... meaning, 'doesn't like to talk to reporters'."
A une époque où il n’y a rien de pire que de vouloir garder sa vie privée… privée, et où on devient célèbre en déféquant devant une webcam, un tel refus de la publicité peut surprendre. Pour ma part, je trouve sain qu’il y ait encore des gens comme Pynchon qui décident de creuser un fossé entre eux et les médias. Ceux-ci, gonflés de leur certitude d’être le quatrième pouvoir, celui à qui on doit parler, parce que « les gens ont le droit de savoir, mon bon monsieur ! », ne comprennent pas qu’on les rejette. Naît ainsi un mythe, le portrait d’une bête étrange, un Benny Profane qui serait prêt à descendre dans les égouts non pas pour chasser l’alligator, mais bien pour éviter les feux de la rampe. Moi, je vois surtout un homme qui refuse de se mettre entre le lecteur et son œuvre : il pense sans doute que tout ce qu’il a dire d’intéressant s’y trouve.
Cette vision de l’homme Pynchon vous paraîtra sans doute un peu légère, pleine de conclusions hâtives et de partis pris étranges. J’en suis le premier conscient. Ce blog a bien sûr une fonction commentaire. J’attends le vôtre avec impatience : comment voyez vous le personnage ?
Le Québec selon Saint William
Je n’avais pas été entièrement convaincu par « Les fusils », le troisième volume publié de la série « Seven Dreams » de William T. Vollmann. Un très bon livre, mais il manquait un petit je ne sais quoi pour que ce soit une réussite totale. J’ai récemment lu « Fathers and crows », le deuxième rêve, et là, je dois dire que ça m’a subjugué.
Ce volume de l’impressionnante entreprise Vollmanienne – en bref, il s’agit de faire une cartographie onirique des relations entre indigènes et colonisateurs depuis le 11eme siècle- est consacré à l’évangélisation du Canada par des jésuites français au 17eme siècle. Le sujet est fascinant, et n’a sans doute jamais été abordé en fiction.
C'est un récit éminemment réaliste et irréaliste. Une œuvre historique, un œuvre d’imagination pure. Un roman mythique et mystique. « Fathers and crows » est une fois de plus un livre bâtard, multi-genre, polymorphe. On est perpétuellement balancé entre plusieurs Vollmann. Il y a le journaliste qui se promène dans le Québec moderne et enquête sur ce qu’il reste de l’époque de la colonisation. Il y a l’historien qui raconte de manière très précise la fondation des villes, les mœurs des nouveaux arrivants, les relations commerciales avec les indigènes. Il y a l’ethnologue qui lève le voile sur le mode de vie « primitif ». Il y a le fabuliste qui se lance dans de grands récits mythologiques, reprenant les légendes existantes, en inventant de nouvelles. Il y a le romancier qui assure une narration absolument palpitante. Il y a, en fin de compte, un touche à tout de génie.
Je reste sous le coup des descriptions de la vie de Jean de Brébeuf, futur Saint, et de son martyr, ainsi que de celle de Champlain, le fondateur de la ville de Québec, idéaliste manipulé et piètre stratège. L’auteur réussit également le pari le plus difficile : celui de ne pas céder à la tentation de décrire les indiens comme des anges pervertis par les européens. Il reste à équidistance sans jamais sombrer dans le relativisme idiot et a un regard acéré sur toutes les parties en présence. Je suis également fasciné par sa capacité à donner des pistes d’explication cohérentes à travers une anecdote simple. C’est particulièrement lumineux lorsqu’il s’agit d’illustrer la manière dont les Hollandais et les Français se sont faits la guerre par indiens interposés, ou de suggérer les raisons du rejet des jésuites par les Hurons qui les avaient initialement acceptés.
Comme d’habitude, Vollmann ne pense pas plus que « less is more » (990 pages dont 120 de glossaire, notes, chronologie, etc) qu’il n’est adepte de la ligne droite. C’est un récit tout en circonvolutions et digressions, où retours en arrière et fast forwards se succèdent. Là, déjà, on est impressionné parce que jamais l’auteur ne perd le lecteur, ne le laisse perdre de vue son plan central. Dans le chaos apparent, il y a un ordre prégnant, dicté par un chef d’orchestre dont la baguette est remplacée par une plume. Et pas n’importe laquelle : celle d'un styliste absolument fascinant.
N’y allons pas par quatre chemins : « Fathers and crows » est un roman fantastique, qui exige beaucoup du lecteur mais qui donne énormément en retour. Une œuvre aboutie, majeure, d’un auteur qui n’avait alors que 33 ans. Indispensable.
William T. Vollmann, Fathers and crows, Penguin, $15.00
Nouvelles du front (8)
- On apprend stupéfait que William Faulkner a écrit le script d’un film de… vampire. Et comme si la surprise n’était déjà pas assez grande, cette histoire ne se déroule même pas dans le Yoknapatawpha County, mais bien en Europe Centrale. Mais qui sait, peut-être que le chasseur de vampire s’appelle Quentin Compson ? Ca aurait pu être une belle pièce pour la collection d’ « unproduced screenplays » de Pugnax.
- Quand Hunter fait boum ! L’action véritable commence après une minute. On peut vraiment assurer que Raoul Duke « went off with a (double) blast ».
- David Markson a de l’actu’ : réédition de « Epitaph for a tramp » et « Epitaph for a deadbeat » en un volume le mois prochain et nouveau roman, « The last novel », en mai prochain. Et peut-être même une traduction française à l’automne…
Marche forcée
« Billy Bathgate » est l’histoire de l’ascension dans le monde du crime new-yorkais d’un jeune gars plutôt débrouillard. Un bon début, et puis la magie disparaît et ça devient franchement chiant. Moi qui ai toujours aimé les histoires de gangsters… « Le plongeon Lumme » met en présence Joe, un vagabond, et un milliardaire mégalo. C’est une allégorie de l’Amérique des années ’30, celle de la crise, de la violence et des luttes syndicales. C’est surtout confus, agaçant et instantanément oubliable.
On voit bien l’intention de Doctorow : établir une histoire des Etats-Unis à travers la fiction – et de fait, son œuvre couvre pratiquement l’ensemble du vingtième siècle. Malheureusement, je pense qu’il échoue. Contrairement à un Vollmann, qui arrive à insuffler à ses récits une dimension proprement mythique tout en garantissant un souci du détail et de l’authenticité qui instruit autant qu’il réjouit le lecteur, Doctorow se contente trop souvent de poncifs.
Malgré tout, j’ai persévéré : je viens de lire « The March », finaliste du National Book Award 2005. La marche en question, c’est celle du Général Sherman et des troupes de l’Union commencée après la prise d’Atlanta et qui se termine avec le fin de la guerre civile. Encore un sujet qui m’intéresse : une bonne partie de mon enfance fut passée à lire « Les tuniques bleues » puis « Blueberry ».
Selon moi, ce livre vient en deuxième position derrière « Ragtime », mais reste un peu « court ». En fait, c’est comme se laisser emporter par la mer. Doctorow est parfois sur la vague, et parfois au creux de celle-ci. Les scènes de batailles ainsi que la description des pratiques médicales sur le terrain sont absolument fascinantes. Le général Sherman tel que décrit dans ces pages est un personnage marquant et complexe. Il fascine et répugne à la fois, c’est là une grande réussite – mais il faut dire que la réalité à donner un sacré coup de main à l'auteur.
Le problème, il me semble, est que chaque personnage est choisi et composé dans un but édificateur. Doctorow ne construit pas sur ses personnages, il les façonne chacun dans un but très précis, afin d’illustrer, qui une personnalité ou un comportement, qui une catégorie sociale, qui une origine ethnique. Ca peut marcher, j’imagine, mais là, ça paraît beaucoup trop souvent artificiel.
Enfin de compte, on ne croit aux évènements qu’à de beaucoup trop rares occasions. Doctorow n’arrive à faire entrevoir la réalité que trop rarement, et il n’arrive pas plus à soulever l’enthousiasme pour sa fiction.
Je me souviens avoir lu une critique laissé par un lecteur qui reprochait au livre de ne pas avoir une histoire claire et de compter trop de personnages. C’est le genre de reproche assez typique qui est fait par l’amateur de narration linéaire et « plot-driven » à des livres un peu plus littéraires. Les livres de Doctorow sont ce qu’on appelle chez les anglo-saxons de « Literary fictions », et ils ont la chance de se vendre très bien, franchissant les barrières qui séparent la littérature dite sérieuse des lecteurs de roman populaires. Formidable, mais si pour l’amateur de Dan Brown, « The March » sera sans doute trop, pour moi il est trop peu. Non, définitivement, je n’accroche pas à l’œuvre d’Edgar Lawrence Doctorow.
Que le lecteur qui l’apprécie me signale un autre de ses livres qui pourrait me plaire. Je veux bien essayer encore une fois.
E.L. Doctorow, The March, Little, Brown, £11.99
And the winner is...
Le National Book Award 2006 va à Richard Powers pour "The echo maker". Voilà donc une récompense pleinement méritée! Que ceux qui ne lisent qu'en français ne désespèrent pas : il semble que la traduction est en cours. Parution prévue, sauf erreur de ma part, en 2008, dans la collection Lot49 du Cherche-midi.
Le jour de gloire est arrivé
C’est ce soir à New York que l’on saura qui a remporté le National Book Award 2006 en fiction. Puisque je vous ai parlé des cinq finalistes, un bref récapitulatif (l’article complet est disponible en cliquant sur les liens) dans mon ordre de préférence.
Richard Powers, The Echo Maker
Un roman d’idées comme on en fait trop peu. Powers y démontre tout son talent et se coltine les grands sujets tout en faisant preuve d'une splendide compréhension de l’humain. Un roman indispensable.
Mark Z. Danielewski, Only Revolutions
Le titre aventureux de la liste. Il ne m’a pas fait le même choc que « House of leaves », mais c’est une œuvre puissante et osée, à placer sous le signe de John Barth et William H. Gass.
Jess Walter, The Zero
Les USA post-9/11 en version absurdistan. Le « Slaughterhouse-five » de l’époque, en moins bon. On y passe d’excellents moments, c’est très prometteur, mais au final on reste un peu sur sa faim.
Dana Spiotta, Eat the Document
Le récit gentillet et romantique d’une radicale des années ’70 et de son fils dans les années altermondialistes. Inoffensif. Le grand livre sur ce sujet potentiellement fécond reste à écrire.
Ken Kalfus, A disorder peculiar to the country
Ou comment ruiner une excellente idée. Kalfus commence bien, avant que ça devienne une incroyable pantalonnade. S’il remportait la récompense, ce serait vraiment embarrassant.
Retour dans le labyrinthe
Selon Barth, les écrivains sont généralement soit des sprinteurs, soit des marathoniens. Lui-même se classe dans la deuxième catégorie. En tant que lecteur, j’avoue trouver rarement du plaisir à la lecture de nouvelles – celles de Cortazar étant une exception parmi quelques rares autres. C’est donc avec quelque appréhension que je me suis lancé dans ce livre qui a la réputation d’être particulièrement ardu.
Comme souvent, la différence entre ce que l’on en a dit et ce qui l’en est réellement est grande. Certes, quarante ans après la première publication, certaines interrogations ou certains éléments stylistiques peuvent paraître désuets. Il n’en reste pas moins une œuvre de fiction puissante et une réflexion extrêmement riche et fertile, qui touchera l’amateur imagination débridée et de jeux littéraires, sans que son background académique n’importe outre mesure.
En opérant un fameux raccourci, je dirais que les sept premières histoires de « Lost in the funhouse » sont plutôt d’ordre domestique, avec, dans plusieurs d’entres-elles, un personnage récurrent nommé Ambrose que l’on suit de la conception à l’adolescence, période au cours de laquelle il se construit son identité, sa propre mythologie. Et c’est justement principalement de mythologie dont il est question dans la seconde moitié, mais vue peut-être comme une suite d’imbroglios conjugaux.
Signalons de manière totalement arbitraire trois des pièces reprises dans le livre. Tout d’abord, celle qui donne son titre à l’ouvrage. Sous les atours d’une banale visite familiale à un par d’attraction une après-midi de quatre juillet, se dissimule en fait un récit autobiographique où John Barth s’interroge sur le fonctionnement de la narration et fait part de sa « révélation » : « He will construct funhouses for others and be their secret operator- though he would rather be among the lovers for whom funhouses are designed ».
« Menelaiad » est un récit remarquable où Menelaus conte de façon möbienne – si cela veut dire quelque chose- sa relation avec Hélène, son amour, son mariage, la guerre de Troie, le retour de la guerre, la vie conjugale. Texte en poupée russe, Menelaus se raconte à divers époques, se raconte racontant, se raconte se racontant racontant, etc…
Enfin, Barth conclut son volume avec « Anonymiad », l’histoire d’un ménestrel abandonné sur une île déserte, et qui ressasse toutes les formes narratives imaginables avant d’être certain de les avoir épuisées. C’est alors qu’il ramasse une bouteille jetée à la mer et y découvre un message qui va lui redonner foi en la capacité créatrice. C’est un message d’amour de Barth à son art : le recyclage postmoderne n’écarte pas l’originalité, ne prononce pas morte la créativité, n’implique pas le refus de la communication et le replis dans ses propres jeux.
« Lost in the funhouse » n’est certainement pas la cup of tea de tout le monde. Il y a pourtant de nombreuses perles à y trouver, et c’est une lecture indispensable pour tout qui s’intéresse à ce qui s’est passé en littérature dans les années 1960, mais aussi à ceux pour qui le langage et le récit sont les choses qui font que la vie mérite d’être vécue.
John Barth, Lost in the funhouse, Anchor Books, $13