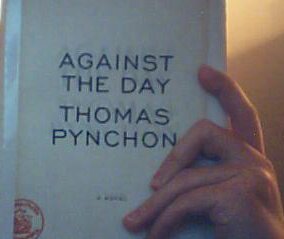Un mur contre le peuple de papier
Né en 1976 à Guadalajara, Plascencia est arrivé à El Monte, Californie, à l’âge de huit ans. Il ne parlait pas un mot d’anglais. Vingt-deux ans plus tard, le voilà doctorant en littérature et surtout auteur de « The people of paper », un remarquable premier roman. Refusé par toutes les grandes maisons, c’est McSweeney’s qui a décidé de l’éditer aux USA. Grâce soit rendue à Dave Eggers.
Il n’est pas simple de faire justice à ce livre. C’est un récit mythologique abordant à la fois la création de l’espèce humaine, l’immigration mexicaine, l’amour déçu, la difficulté d’écrire et une étrange guerre entre un homme qui mouille son lit et l’omnisciente Saturne. Le tour de force est de rendre cet ensemble cohérent et facile d’accès, sans jamais être simpliste ni en paraître prétentieux.
Plascencia a un véritable sens poétique, une grande sensibilité, une imagination débridée et un sens de l’humour et de la dérision irrésistible. En cela, il fait penser à un George Saunders débarrasser des scories politiques et doté d’une plume plus chantante – si ça veut dire quelque chose… Par ailleurs, une large partie du livre s’intéresse au rapport entre l’écrivain et sa création à travers l’intervention directe de l’auteur comme protagoniste de son récit, opposé à la lutte de ses personnages pour leur liberté. C’est un thème classique, mais il est exceptionnel de voir à quel point il arrive à faire passer le message d’une façon légère et profonde. C’est une discussion post-moderne qui serait amusante pour n’importe quel lecteur. Chapeau bas.
Terminons par une autre grande qualité de ce livre : sa mise en page, de prime abord chaotique. Trop souvent, on se met à jouer avec la forme pour faire bien et cacher le vide de la narration. Rien de cela ici : Plascencia trouve à chaque chapitre la forme idoine pour accrocher le lecteur et coller au sens du texte. Tout cela nous donne un livre qui est à la fois un bel objet, une remarquable réflexion philosophique et une superbe histoire sur l’amour et la place de l’homme dans l’univers. Je vous assure que les personnages vont rester en vous et ressortir quand vous ne vous y attendrez pas…
Voilà un premier roman qui mérite tous les applaudissements et introduit un auteur dont on peut espérer les plus belles choses dans les années à venir. Puisque Dubya s’est paraît-il mis à lire, « People of paper » est un livre que Laura devrait lui offrir pour Noël…
Salavador Plascencia, « The people of paper », Bloomsbury, £14.99
Nouvelles du Pynch (2)
Lire « Against the day » est une expérience qui exige du lecteur plus de temps qu’un roman ordinaire. Pas seulement parce que c’est évidemment plus complexe et plus profond que la majorité des titres publiés cette année, mais surtout parce que la prose de Pynchon est un plaisir permanent qui arrête le regard, qui force à lire et à relire certains passages et puis à s’arrêter quelques instants pour y penser. C’est donc relativement fatigant, et ça bouleverse quelque peu mon rythme habituel.
En général, je lis dans le bus jusqu’au travail, en marchant entre l’arrêt et le bureau, pendant l’heure de table et puis de nouveau dans le bus sur le chemin du retour. Une fois à la maison, si je n’ai rien d’autre de prévu, c’est reparti pour trois heures de lecture. Ce régime est impossible à maintenir avec AtD, que je ne peux lire qu’assis confortablement avec un dictionnaire et une connexion internet à portée de main. Voilà pourquoi je prends un autre livre avec moi au boulot, quelque chose de plus léger, plus reposant. J’ai donc commencé « The joke’s over », mémoires du fameux illustrateur Ralph Steadman concernant sa relation de travail avec Hunter S. Thompson.
Hier, je suis tombé sur le récit de leur première collaboration à l’occasion du Kentucky Derby. Gallois jamais sorti de son pays, Steadman va se rendre compte avec horreur qu’il est impossible de dessiner le portrait d’un américain et de le présenter ensuite au modèle : il va prendre très, très mal la caricature. Le dessinateur de s’exclamer « it took me quite a while (…) to realize that Kentuckians (…) take things like that as a personal comment and even, in some cases, an insult, comparable to a smack in the mouth ».
A la lecture de ce passage, je me suis demandé quelle pourrait bien être la vision américaine de ce genre de malentendu. Et j’ai tout d’un coup réalisé que Thomas Pynchon me l’avait donnée en page 224, deux heures auparavant.
« On this island, as you will have begun to notice, no one ever speaks plainly. (…) Any who may come to feel betrayed by them, insulted, even hurt, even grievously, are simply ‘taking it too seriously’ The English exercise their eyebrows and smile and tell you it’s ‘irony’ or ‘a bit of fun’, for it’s only a combination of letters after all, isn’t it. »
On parle ici de langue, et Steadman de dessin, mais on parle surtout de tournure d’esprit, de façon de penser. Mis en regard, les deux passages se font écho, comme deux points de vue radicalement différents sur une même scène. Le hasard ( ?) fait bien les choses.
Un tunnel de mots
Comment parler d’un tel livre ? Comment ne pas faire insulte à la prose splendidement étalée sur 651 pages ? Faut-il oser taper des mots à la suite de ces mots lus, avec la certitude de passer pour un couillon qui aurait mieux fait de la fermer et de garder ses yeux bien fixés sur le volume ? Pas le choix, il est trop tard pour reculer…
« The Tunnel » est un livre épuisant, pénible, exigeant, difficile, dans le fond comme dans la forme. C’est aussi un livre splendide, fascinant, courageux, admirable. Un sommet. William Frederick Kohler, professeur d’histoire d’une cinquantaine d’années, vient de terminer le manuscrit de l’étude de toute une vie, « Guilt and innocence in Hitler’s Germany » et tente d’en écrire l’introduction. Peut-être paralysé par la perspective de mettre ainsi une note finale à son grand œuvre, il bloque et écrit à la place sa propre histoire.
Maudissant une existence passée sur une chaise ou sur le trône à être victime du « fascisme du cœur », Kohler ressasse les épisodes de sa vie. Les heures à être dans les bras et surtout dans le con de son ex-maîtresse, sa vie d’enfant avec une mère alcoolique et un père autoritaire et raciste, sans amis, développant déjà d’étranges passions, son parcours universitaire, son rôle de pater familias. Il trouve une sorte d’équilibre lorsqu’il se met à creuser un tunnel dans la cave, dissimulant son œuvre à sa femme, comme il lui cache son excavation mentale en mélangeant les pages de son autoportrait et celles de son œuvre académique.
Kohler est un être détestable, répugnant. Marié à Martha, cette femme qui ne veut plus écarter les cuisses, il ne sait pas s’il la hait ou s’il se fout d’elle. Ensemble, ils ont eu deux enfants avec qui il n’a aucune relation – il y en a même un dont il refuse de prononcer le prénom. A l’université, il est entouré de collègues à moitié fous, qui lui reprochent d’essayer perpétuellement de mettre la main dans les culottes de ses étudiantes en échange de bonnes notes. Ceux qui assistent à ses cours le traitent régulièrement de nazi – et il faut dire que le bon professeur n’aime pas vraiment les juifs et ressent une étrange empathie pour les dirigeants du NSDAP.
On travaille ici dans l’ordure, dans le scatologique, dans l’hypersexué. Tout est en place pour faire une œuvre repoussante. Et c’est là que le miracle de l’écriture opère. William H. Gass a creusé un tunnel à même le langage, une descente dans les profondeurs du verbe, un travail inouï pour en sortir la prose la plus pure, le style le plus parfait, le plus original imaginable. C’est une petite musique qu’on entend en lisant, une mélodie, quelque chose d’indescriptible. Il y a le rythme, le son, la poésie, il y a les mots, leurs enchaînements, les phrases, les paragraphes, et ils sont presque tous parfaits.
C’est peut-être la dernière œuvre majeure du vingtième siècle, et c’est sans doute aussi la plus facilement haïssable. Il est compliqué de ne pas être dérangé par la personnalité de Kohler, mais il me semble impossible de ne pas être fasciné par cette écriture, cette composition, cette architecture narrative d’un modernisme stupéfiant. Et finalement, c’est peut-être ça qui a provoqué le rejet de certains : si le narrateur est aussi détestable, il est scandaleux que la prose magnifie son propos et que l’auteur ne le rejette pas ouvertement. C’est l’erreur commise en 1955 au sujet de Humbert Humbert. Tant pis pour les censeurs : la littérature n’est pas toujours pour les cœurs sensibles, et « The tunnel » est une saisissante œuvre d’Art qui bouleversera celui qui aura le courage de s’y plonger.
William H. Gass, The Tunnel, Dalkey Archive, $15.95
Le Cherche-midi publiera en 2007 la traduction de Christophe Claro dans la collection Lot49. Je suis très curieux de voir comment le côté politiquement incorrect du texte va être accueilli en France.
Nouvelles du Pynch
Il est enfin entre mes mains ! Il va falloir du temps pour en arriver à bout, mais jusqu’ici c’est un vrai plaisir. Ah, retrouver la prose de Pynchon !
Juste une petite remarque en passant. Les premières pages de « Against the day » se déroulent à Chicago, ville d’où vient Augie March, le célèbre personnage de Saul Bellow. La première ligne de cette œuvre est rentrée dans l’histoire littéraire – il faut dire qu’elle est superbe :
“I am an American, Chicago born—Chicago, that somber city—and go at things as I have taught myself, free-style, and will make the record in my own way: first to knock, first admitted; sometimes an innocent knock, sometimes a not so innocent. But a man’s character is his fate…”
Chicago, that somber city. Ou comment décrire une ville en un seul mot. Un mot parfait dans une phrase parfaite.
A la page 41 de « Against the Day », Pynchon décrit
“Out the window in the distance, contradicting the prairie, a mirage of downtown Chicago ascended to a kind of lurid acropolis, its light as if from nightly immolation warped to the red end of the spectrum, smoldering as if always just about to explode into open flames.”
C’est du Pynchon au sommet de sa forme, c’est aussi le genre de passage que détestent ceux qui ne l’aiment pas. Le mot de Bellow est plus puissant, mais la phrase de Pynchon est infiniment plus belle. Lurid, somber, deux mots qui semblent s’opposer, mais qui décrivent la même réalité. J’adore le Pynch’ quand il permet au cortex de trouver des connexions de ce type. Encore, encore ! J’en demande encore plus !
Le mythe du reclus
Il est impossible de ne pas s’être rendu compte qu’un nouveau Pynchon vient de sortir. Des articles paraissent partout, du NY Times au plus modeste des blogs (celui-ci, par exemple). Et avec ce foisonnement de papiers, toujours ce lancinant refrain, cette ritournelle à laquelle il est impossible d’échapper : Pynchon, l’écrivain reclus. Mais est-ce vraiment un qualificatif pertinent ?
Le journaliste paresseux à l’habitude de comparer le Pynch’ avec Salinger – un rumeur disant qu’il s’agissait du même homme a d’ailleurs circulé. Certes, au niveau littéraire, il n’y a pas photo. Par contre, au niveau de l’isolement, il paraît que c’est kif kif bourricot. Le père de Holden Caulfield n’a pas fait une seule apparition publique depuis 1965, à peu près à l’époque de son divorce, et après dix ans de retrait progressif d’un grand monde qu’il fréquentait pourtant avec assiduité. Dans les années ’90, Ian Hamilton décide d’écrire une biographie de Salinger. Apprenant la nouvelle, l’auteur lance des poursuites contre son biographe : hors de question d’écrire un tel livre. Finalement, il sortira quand même sous le titre « A la recherche de JD Salinger », portrait sans complaisance d’un homme presque mentalement malade, réfugié derrière les murs de sa propriété, n’y laissant rentrer que l’une ou l’autre personne, au gré de ses lubies. Quelques années plus tard, Margaret, sa propre fille, publiera son témoignage, radicalement différent : il y est décrit comme un globe-trotter, bon vivant, parfaitement équilibré. La vérité est sans doute quelque part entre les deux.
Et Pynchon là dedans ? On a vraiment entendu tout et n’importe quoi. Il a été tout à tour Salinger donc, sympathisant des Davidiens, Wanda Tinasky ou encore le UNA Bomber. La dernière photo certifiée date de 1957, il n’a pas plus accordé d’interviews qu’il n’a été vu lors des remises de récompenses qui lui ont été attribuées. Ajoutons à ça une œuvre où la paranoïa et la clandestinité figurent en bonne place, et il faut bien admettre que tous les ingrédients sont en place pour en faire l’America’s most reclusive writer. Et pourtant…
Personne ne lui a encore consacré de biographie (bonne chance au volontaire !), mais lorsque un sitcom américain base un de ses épisodes sur une rencontre avec Pynchon et fait parvenir le script à son agent, ce n’est pas un avocat qu’on envoie, mais bien une réponse enthousiaste de l’écrivain. Il demandera tout de même des changements : certains détails du script ne lui correspondent pas assez !
Par ailleurs, certains détaillent glanés à droite et à gauche cadrent mal avec cette notion de reclus : on parle de lui fumant des joints avec Brian Wilson, il écrit sur les émeutes de Watts, rencontre Salman Rushdie, dîne avec Ian McEwan lorsqu’il est de passage à New York, assiste à la remise de diplôme de sa nièce, conduit son fils à l’école. En 2004, il accepte le scénario d’un épisode des Simpsons où il est censé faire une apparition et se rend en studio pour enregistrer lui-même le texte. Au vu du texte qu’il a sanctionné, je pense que tout doute sur son attitude envers sa réputation s’évapore : il en rigole bien de cette bonne blague.
C’est d’ailleurs tellement simple de trouver Pynchon quand on le cherche qu’il n’aura fallu que quelques jours à une équipe de CNN pour le filmer se promenant à NY. Et c’est à cette occasion là qu’est sans doute tombé l’élément qui permet le mieux de comprendre ce qu’il faut penser de ce terme de reclus. Furieux d’avoir été surpris, il contacte la chaîne, demandant à ne pas être identifié à l’antenne. On lui demande son avis sur la réputation qu’il a. La réponse est claire : "My belief is that 'recluse' is a code word generated by journalists ... meaning, 'doesn't like to talk to reporters'."
A une époque où il n’y a rien de pire que de vouloir garder sa vie privée… privée, et où on devient célèbre en déféquant devant une webcam, un tel refus de la publicité peut surprendre. Pour ma part, je trouve sain qu’il y ait encore des gens comme Pynchon qui décident de creuser un fossé entre eux et les médias. Ceux-ci, gonflés de leur certitude d’être le quatrième pouvoir, celui à qui on doit parler, parce que « les gens ont le droit de savoir, mon bon monsieur ! », ne comprennent pas qu’on les rejette. Naît ainsi un mythe, le portrait d’une bête étrange, un Benny Profane qui serait prêt à descendre dans les égouts non pas pour chasser l’alligator, mais bien pour éviter les feux de la rampe. Moi, je vois surtout un homme qui refuse de se mettre entre le lecteur et son œuvre : il pense sans doute que tout ce qu’il a dire d’intéressant s’y trouve.
Cette vision de l’homme Pynchon vous paraîtra sans doute un peu légère, pleine de conclusions hâtives et de partis pris étranges. J’en suis le premier conscient. Ce blog a bien sûr une fonction commentaire. J’attends le vôtre avec impatience : comment voyez vous le personnage ?
Le Québec selon Saint William
Je n’avais pas été entièrement convaincu par « Les fusils », le troisième volume publié de la série « Seven Dreams » de William T. Vollmann. Un très bon livre, mais il manquait un petit je ne sais quoi pour que ce soit une réussite totale. J’ai récemment lu « Fathers and crows », le deuxième rêve, et là, je dois dire que ça m’a subjugué.
Ce volume de l’impressionnante entreprise Vollmanienne – en bref, il s’agit de faire une cartographie onirique des relations entre indigènes et colonisateurs depuis le 11eme siècle- est consacré à l’évangélisation du Canada par des jésuites français au 17eme siècle. Le sujet est fascinant, et n’a sans doute jamais été abordé en fiction.
C'est un récit éminemment réaliste et irréaliste. Une œuvre historique, un œuvre d’imagination pure. Un roman mythique et mystique. « Fathers and crows » est une fois de plus un livre bâtard, multi-genre, polymorphe. On est perpétuellement balancé entre plusieurs Vollmann. Il y a le journaliste qui se promène dans le Québec moderne et enquête sur ce qu’il reste de l’époque de la colonisation. Il y a l’historien qui raconte de manière très précise la fondation des villes, les mœurs des nouveaux arrivants, les relations commerciales avec les indigènes. Il y a l’ethnologue qui lève le voile sur le mode de vie « primitif ». Il y a le fabuliste qui se lance dans de grands récits mythologiques, reprenant les légendes existantes, en inventant de nouvelles. Il y a le romancier qui assure une narration absolument palpitante. Il y a, en fin de compte, un touche à tout de génie.
Je reste sous le coup des descriptions de la vie de Jean de Brébeuf, futur Saint, et de son martyr, ainsi que de celle de Champlain, le fondateur de la ville de Québec, idéaliste manipulé et piètre stratège. L’auteur réussit également le pari le plus difficile : celui de ne pas céder à la tentation de décrire les indiens comme des anges pervertis par les européens. Il reste à équidistance sans jamais sombrer dans le relativisme idiot et a un regard acéré sur toutes les parties en présence. Je suis également fasciné par sa capacité à donner des pistes d’explication cohérentes à travers une anecdote simple. C’est particulièrement lumineux lorsqu’il s’agit d’illustrer la manière dont les Hollandais et les Français se sont faits la guerre par indiens interposés, ou de suggérer les raisons du rejet des jésuites par les Hurons qui les avaient initialement acceptés.
Comme d’habitude, Vollmann ne pense pas plus que « less is more » (990 pages dont 120 de glossaire, notes, chronologie, etc) qu’il n’est adepte de la ligne droite. C’est un récit tout en circonvolutions et digressions, où retours en arrière et fast forwards se succèdent. Là, déjà, on est impressionné parce que jamais l’auteur ne perd le lecteur, ne le laisse perdre de vue son plan central. Dans le chaos apparent, il y a un ordre prégnant, dicté par un chef d’orchestre dont la baguette est remplacée par une plume. Et pas n’importe laquelle : celle d'un styliste absolument fascinant.
N’y allons pas par quatre chemins : « Fathers and crows » est un roman fantastique, qui exige beaucoup du lecteur mais qui donne énormément en retour. Une œuvre aboutie, majeure, d’un auteur qui n’avait alors que 33 ans. Indispensable.
William T. Vollmann, Fathers and crows, Penguin, $15.00
Nouvelles du front (8)
- On apprend stupéfait que William Faulkner a écrit le script d’un film de… vampire. Et comme si la surprise n’était déjà pas assez grande, cette histoire ne se déroule même pas dans le Yoknapatawpha County, mais bien en Europe Centrale. Mais qui sait, peut-être que le chasseur de vampire s’appelle Quentin Compson ? Ca aurait pu être une belle pièce pour la collection d’ « unproduced screenplays » de Pugnax.
- Quand Hunter fait boum ! L’action véritable commence après une minute. On peut vraiment assurer que Raoul Duke « went off with a (double) blast ».
- David Markson a de l’actu’ : réédition de « Epitaph for a tramp » et « Epitaph for a deadbeat » en un volume le mois prochain et nouveau roman, « The last novel », en mai prochain. Et peut-être même une traduction française à l’automne…
Marche forcée
« Billy Bathgate » est l’histoire de l’ascension dans le monde du crime new-yorkais d’un jeune gars plutôt débrouillard. Un bon début, et puis la magie disparaît et ça devient franchement chiant. Moi qui ai toujours aimé les histoires de gangsters… « Le plongeon Lumme » met en présence Joe, un vagabond, et un milliardaire mégalo. C’est une allégorie de l’Amérique des années ’30, celle de la crise, de la violence et des luttes syndicales. C’est surtout confus, agaçant et instantanément oubliable.
On voit bien l’intention de Doctorow : établir une histoire des Etats-Unis à travers la fiction – et de fait, son œuvre couvre pratiquement l’ensemble du vingtième siècle. Malheureusement, je pense qu’il échoue. Contrairement à un Vollmann, qui arrive à insuffler à ses récits une dimension proprement mythique tout en garantissant un souci du détail et de l’authenticité qui instruit autant qu’il réjouit le lecteur, Doctorow se contente trop souvent de poncifs.
Malgré tout, j’ai persévéré : je viens de lire « The March », finaliste du National Book Award 2005. La marche en question, c’est celle du Général Sherman et des troupes de l’Union commencée après la prise d’Atlanta et qui se termine avec le fin de la guerre civile. Encore un sujet qui m’intéresse : une bonne partie de mon enfance fut passée à lire « Les tuniques bleues » puis « Blueberry ».
Selon moi, ce livre vient en deuxième position derrière « Ragtime », mais reste un peu « court ». En fait, c’est comme se laisser emporter par la mer. Doctorow est parfois sur la vague, et parfois au creux de celle-ci. Les scènes de batailles ainsi que la description des pratiques médicales sur le terrain sont absolument fascinantes. Le général Sherman tel que décrit dans ces pages est un personnage marquant et complexe. Il fascine et répugne à la fois, c’est là une grande réussite – mais il faut dire que la réalité à donner un sacré coup de main à l'auteur.
Le problème, il me semble, est que chaque personnage est choisi et composé dans un but édificateur. Doctorow ne construit pas sur ses personnages, il les façonne chacun dans un but très précis, afin d’illustrer, qui une personnalité ou un comportement, qui une catégorie sociale, qui une origine ethnique. Ca peut marcher, j’imagine, mais là, ça paraît beaucoup trop souvent artificiel.
Enfin de compte, on ne croit aux évènements qu’à de beaucoup trop rares occasions. Doctorow n’arrive à faire entrevoir la réalité que trop rarement, et il n’arrive pas plus à soulever l’enthousiasme pour sa fiction.
Je me souviens avoir lu une critique laissé par un lecteur qui reprochait au livre de ne pas avoir une histoire claire et de compter trop de personnages. C’est le genre de reproche assez typique qui est fait par l’amateur de narration linéaire et « plot-driven » à des livres un peu plus littéraires. Les livres de Doctorow sont ce qu’on appelle chez les anglo-saxons de « Literary fictions », et ils ont la chance de se vendre très bien, franchissant les barrières qui séparent la littérature dite sérieuse des lecteurs de roman populaires. Formidable, mais si pour l’amateur de Dan Brown, « The March » sera sans doute trop, pour moi il est trop peu. Non, définitivement, je n’accroche pas à l’œuvre d’Edgar Lawrence Doctorow.
Que le lecteur qui l’apprécie me signale un autre de ses livres qui pourrait me plaire. Je veux bien essayer encore une fois.
E.L. Doctorow, The March, Little, Brown, £11.99
And the winner is...
Le National Book Award 2006 va à Richard Powers pour "The echo maker". Voilà donc une récompense pleinement méritée! Que ceux qui ne lisent qu'en français ne désespèrent pas : il semble que la traduction est en cours. Parution prévue, sauf erreur de ma part, en 2008, dans la collection Lot49 du Cherche-midi.
Le jour de gloire est arrivé
C’est ce soir à New York que l’on saura qui a remporté le National Book Award 2006 en fiction. Puisque je vous ai parlé des cinq finalistes, un bref récapitulatif (l’article complet est disponible en cliquant sur les liens) dans mon ordre de préférence.
Richard Powers, The Echo Maker
Un roman d’idées comme on en fait trop peu. Powers y démontre tout son talent et se coltine les grands sujets tout en faisant preuve d'une splendide compréhension de l’humain. Un roman indispensable.
Mark Z. Danielewski, Only Revolutions
Le titre aventureux de la liste. Il ne m’a pas fait le même choc que « House of leaves », mais c’est une œuvre puissante et osée, à placer sous le signe de John Barth et William H. Gass.
Jess Walter, The Zero
Les USA post-9/11 en version absurdistan. Le « Slaughterhouse-five » de l’époque, en moins bon. On y passe d’excellents moments, c’est très prometteur, mais au final on reste un peu sur sa faim.
Dana Spiotta, Eat the Document
Le récit gentillet et romantique d’une radicale des années ’70 et de son fils dans les années altermondialistes. Inoffensif. Le grand livre sur ce sujet potentiellement fécond reste à écrire.
Ken Kalfus, A disorder peculiar to the country
Ou comment ruiner une excellente idée. Kalfus commence bien, avant que ça devienne une incroyable pantalonnade. S’il remportait la récompense, ce serait vraiment embarrassant.
Retour dans le labyrinthe
Selon Barth, les écrivains sont généralement soit des sprinteurs, soit des marathoniens. Lui-même se classe dans la deuxième catégorie. En tant que lecteur, j’avoue trouver rarement du plaisir à la lecture de nouvelles – celles de Cortazar étant une exception parmi quelques rares autres. C’est donc avec quelque appréhension que je me suis lancé dans ce livre qui a la réputation d’être particulièrement ardu.
Comme souvent, la différence entre ce que l’on en a dit et ce qui l’en est réellement est grande. Certes, quarante ans après la première publication, certaines interrogations ou certains éléments stylistiques peuvent paraître désuets. Il n’en reste pas moins une œuvre de fiction puissante et une réflexion extrêmement riche et fertile, qui touchera l’amateur imagination débridée et de jeux littéraires, sans que son background académique n’importe outre mesure.
En opérant un fameux raccourci, je dirais que les sept premières histoires de « Lost in the funhouse » sont plutôt d’ordre domestique, avec, dans plusieurs d’entres-elles, un personnage récurrent nommé Ambrose que l’on suit de la conception à l’adolescence, période au cours de laquelle il se construit son identité, sa propre mythologie. Et c’est justement principalement de mythologie dont il est question dans la seconde moitié, mais vue peut-être comme une suite d’imbroglios conjugaux.
Signalons de manière totalement arbitraire trois des pièces reprises dans le livre. Tout d’abord, celle qui donne son titre à l’ouvrage. Sous les atours d’une banale visite familiale à un par d’attraction une après-midi de quatre juillet, se dissimule en fait un récit autobiographique où John Barth s’interroge sur le fonctionnement de la narration et fait part de sa « révélation » : « He will construct funhouses for others and be their secret operator- though he would rather be among the lovers for whom funhouses are designed ».
« Menelaiad » est un récit remarquable où Menelaus conte de façon möbienne – si cela veut dire quelque chose- sa relation avec Hélène, son amour, son mariage, la guerre de Troie, le retour de la guerre, la vie conjugale. Texte en poupée russe, Menelaus se raconte à divers époques, se raconte racontant, se raconte se racontant racontant, etc…
Enfin, Barth conclut son volume avec « Anonymiad », l’histoire d’un ménestrel abandonné sur une île déserte, et qui ressasse toutes les formes narratives imaginables avant d’être certain de les avoir épuisées. C’est alors qu’il ramasse une bouteille jetée à la mer et y découvre un message qui va lui redonner foi en la capacité créatrice. C’est un message d’amour de Barth à son art : le recyclage postmoderne n’écarte pas l’originalité, ne prononce pas morte la créativité, n’implique pas le refus de la communication et le replis dans ses propres jeux.
« Lost in the funhouse » n’est certainement pas la cup of tea de tout le monde. Il y a pourtant de nombreuses perles à y trouver, et c’est une lecture indispensable pour tout qui s’intéresse à ce qui s’est passé en littérature dans les années 1960, mais aussi à ceux pour qui le langage et le récit sont les choses qui font que la vie mérite d’être vécue.
John Barth, Lost in the funhouse, Anchor Books, $13
Nouvelles de Fausto
Tout m’y attire, car il s’agit peut-être du seul lieu dans le monde où la holy trinity qui fait de Fausto ce qu’il est est présente. Londres, c’est la ville de la musique. Je regarde vers mes rayons, et les Beatles me parlent de Tara Browne qui n’avait pas vu que le feu était passé au rouge, quelque part à Kensington. Et Coil qui nous entretient des « Lost Rivers of London », toutes ces rivières que le touriste ne soupçonne pas et qui s’écoulent sous ses pieds, sous le béton de l’urbanisation. Je me souviens de ce petit magasin abrité dans une maison anonyme d’un faubourg du sud de la ville. Rien n’indiquait que l’adresse était bonne, il fallait sonner. Si on avait de la chance, un homme nullement sympathique venait ouvrir et vous faisait pénétrer dans une hallucinante caverne d’Ali Baba où les douceurs auditives étaient accumulées, de Coil à This Heat, de AMM à l’ensemble du catalogue ReR Megacorps.
Londres, c’est aussi la ville du foot, avec six clubs en Premier League. Et dimanche dernier, dans le salon d’une famille bien British, après le traditionnel Sunday Roast, je me suis levé, je me suis jeté, j’ai crié lorsque Marlon l’a mis au fond, cette balle qui donnait la victoire à mes beloved Hammers face à Arsenal. Et Arsène Wenger d’illustrer une fois de plus pourquoi il est le plus mauvais perdant du sport français – ce n’est pas une mince affaire. Up the Irons ! (On en aura bien besoin…).
Et Londres, c’est surtout une ville littéraire. Promenez vous dans Bloomsbury, suivez les traces de Virginia Woolf. Regardez les caméras dont la ville d’adoption d’un certain Eric Blair est truffée. C’est surtout pour moi la ville où Nicola Six attendait la mort des mains de Keith Talent. Ah, « London Fields » !
A l’aller, je voyage léger. Au retour, je me casse le dos. Impossible de ne pas se laisser aller chez Foyles, la plus grande librairie indépendante du monde. Difficile de ne pas admirer le Waterstone’s de Picadilly, plus grande librairie d’Europe, avec ses sept étages. Les grandes chaînes actives en France et en Belgique devraient y jeter un œil : on reste dans l’industrie plutôt que dans le commerce animé par des passionnés, mais les rayons imports et indépendants y sont (parfois) remarquables.
Faisons le détail, puisque ce voyage animera l’hiver et fournira une partie du charbon que blogger engouffre pour faire fonctionner cette page. Nous devons à l’inestimable Pugnax l’acquisition de « The people of paper » de Salvador Plasencia et des « Suitors » de Ben Ehrenreich (j’envoie la facture si ce n’est pas bon). Je regrette de n’avoir trouvé le « Children Hospital » de Chris Adrian. Claro m’a recommandé « Oh pure and radiant heart » de Lydia Millet, il fut pris également. On est dans les titres récents, nous y resterons : « The brief and frightening reign of Phil » du McArthur Fellow promo ’06 George Saunders, « Wizard of the crows » de Ngugi wa Thiong’o et les souvenirs de Ralph Steadman à propos d’un certain Hunter («The joke’s over », malheureusement, on a envie de dire). Deux classiques américains ensuite : « Wittgenstein’s mistress » de David Markson et « Mumbo Jumbo » d’Ishmael Reed. Au rayon classiques, ceux que j’ai lu en français dans mon enfance, mais que je souhaite avoir sous la main en anglais : une chasse au trésor et les aventures d’un certain détective de Baker Street. Et puis, « The man who was thursday », récit policier d’un Chesterton que je ne connais que poète. Pour les jours de repos, j’ai prévu les éditions paperback des derniers Zadie Smith et Julian Barnes, ainsi que « American tabloid » du père Ellroy. Pour finir, trouvé de seconde main : « The gospel according to the son » de Norman Mailer, parce qu’il y parle de Jésus, ce qui est bien casse-gueule, et que son prochain roman aura Hitler comme protagoniste, c’est qui est tout aussi dangereux.
Un lien tout de même : Brian Evenson propose la playlist de son dernier livre, « The open curtain ». Pratiquement que du bon. Je vous quitte en précisant que ce long message a été écrit alors que Chico Buarque chantait « Construçao ». Le radiateur en guise de soleil, et à la place de caïpirinha, une bonne tasse de Earl Grey. J’arrête là, parce qu’on quitte ma sainte trinité pour rentrer dans le domaine des péchés mignons.
---------------------------------
Lundi 21 à 19h15, heure de Londres, Lawrence Norfolk sera sur la BBC Radio 4 pour parler du nouveau Pynchon. A ne pas manquer…
NBA 2006: Walter - The Zero
2006 est-elle l’année de l’arrivée en masse du 11 septembre sur la scène littéraire ? McInerney et Safran Foer avaient lancés le mouvement il y a un an, et on a maintenant Claire Messud, Ken Kalfus et Richard Powers. A cette liste, on peut ajouter « The Zero » de Jess Walter. Ça fait donc trois romans sur les cinq finalistes du National Book Award.
Le livre commence fort : Brian Remy vient de se mettre une balle dans la tête en nettoyant son arme (ou… ?), mais n’est pas mort. Le lendemain, comme si de rien n’était, il reprend son travail de flic rescapé d’un attentat terroriste dans une ville indéterminée. Depuis l’évènement, il fait visiter le lieu de la catastrophe à des célébrités, accompagné de Guterak, son très loquace et très vulgaire collègue. Après quelques jours de ce régime, il se fait débaucher par une nouvelle agence gouvernementale, chargée de récupérer tous les documents dispersés par l’attaque, qui veut faire concurrence à l’Agence et au Bureau.
Ce qui démarque « The Zero » des autres œuvres approchant ce sujet, c’est la volonté de Jess Walter de faire une satire plutôt féroce de la réaction américaine aux attaques. On est frappé par les descriptions impitoyables des procédés minables et criminels mis en place par les différents services de sécurité afin de paraître sous un meilleur jour – et prendre la main dans la lutte pour le titre de champion de la lutte anti-terroriste. Il n’hésite pas non plus à tailler un costard aux avocats lancés comme des vautours sur les dossiers d’indemnisation de proches des victimes, ainsi qu’aux autorités de la ville – le Giuliani de cette grande ville sans nom d’un pays inconnu en prend pour son grade…
Ceci dit, il ne s'agit pas juste d'une charge méchante. C’est principalement une descente en absurdistan, une plongée dans un monde obsédé par le sécuritaire et réagissant un peu étrangement aux menaces. En fait, Walter escompte avec « The Zero » fournir à la guerre contre le terrorisme l’équivalent du « Slaugtherhouse five » de Vonnegut ou du « Catch-22 » de Heller. Par ailleurs, les dialogues très fréquemment absurdes font un peu penser à ceux que William Gaddis avait composé pour « Jr. ».
Jess Walter a une grande maîtrise narrative. Puisque Remy a des problèmes de mémoire et qu’il oublie régulièrement ce qui s’est passé deux heures auparavant ou se retrouve dans un endroit sans savoir ce qu’il y fait ou doit y faire, les bouts d’histoires se coupent abruptement, on se retrouve dans une scène où il manque le début : le lecteur est mis dans la position du personnage. C’est très bien foutu, et c’est l’élément qui distingue clairement « The Zero » des autres prétendants au National Book Award 2006, dont la narration est plus classique – à l’énorme exception de « Only Revolutions », bien évidemment.
Il reste cependant encore beaucoup de travail à Walter pour être le nouveau Heller ou le Kafka de ce siècle. Si ce livre est habilement composé et agréable à la lecture, ses qualités ne font pas oublier l’impression que l’intrigue tourne en rond avant de se transformer inutilement en une sorte de mélo conjugal. En fait, Jess Walter a souvent du mal à faire naître chez le lecteur de l’empathie pour les personnages. Ce n’est pas un mal en soi dans une satire, mais puisque l’auteur tente, plus on s’approche de la fin, de faire de son livre un drame, c’est assez gênant.
Ne boudons tout de même pas le plaisir ressenti à la lecture, et quittons-nous, une fois n’est pas coutume, avec un petit extrait. Remy rencontre un vieil homme originaire du Moyen-Orient, avec laquelle il pensait être en contact téléphonique, jusqu'à ce que son psy lui dise que c’était son imagination qui le travaillait. Il le lui dit, la réponse prend la forme d’un long monologue.
« You’re always convincing yourselves that the world isn’t what it is, that no one’s reality matters except yours. (…)That’s what happens when a nation becomes a public relation firm. You forget the truth. Everything is the
Jess Walter, The Zero, Regan, $25.95
------------------
Cet article est le dernier d'une série consacrée aux finalistes du National Book Award 2006. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième sont déjà en ligne. Le vainqueur du prix sera annoncé à New York le 15 novembre.NBA 2006: Spiotta - Eat the document
« Eat the document », le second roman de Dana Spiotta, aurait pu être écrit par Don DeLillo – en version moins sensible, plus froide. Mary, jeune radicale du début des années ’70, est en fuite. Une action contre la guerre du Vietnam ayant mal tourné, sa cellule activiste doit se disperser. Elle commence un parcours vers la clandestinité. Il faut se forger une nouvelle identité, une nouvelle histoire, de nouvelles habitudes. Des jours et des nuits de sueurs froides à être toujours aux aguets. 1998, et nous sommes en plein développement de la mouvance alter-mondialiste, alors que résurrection des mouvements radicaux bat son plein. Une nouvelle génération tente, plutôt maladroitement, de prendre le relais.
Le plus intéressant dans ce livre, c’est sans doute la comparaison entre notre époque et le monde d’il y a trente ans. Spiotta les pointe heureusement rarement du doigt, mais les différences / ressemblances parsèment le récit, et il est assez amusant de partir à la chasse. Le roman est rempli de références musicales – on dit souvent les fans obsessionnels sont toujours masculins, donc soit Spiotta a fait de longues recherches, soit elle est un parfait contre-exemple. Les albums et le chansons écoutée par Mary en fuite sont peu ou prou les mêmes que ceux que son fils écoute, presque comme un autiste, seul dans sa chambre de fin de millénaire. Au niveau politique, pour tous les néo-punks, néo-féministes, anticapitalistes, anti-impérialistes, black blockers et autres hackers, les mouvements des années ’70 font référence. Sans les résultats, avec souvent plus de parlote que d’action, en mettant la technologie à profit lorsqu’ils font quelque chose, ils ont les mêmes illusions que leurs aînés.
Spiotta voit la rébellion actuelle comme une chose apprivoisée, la contre-culture séduit toujours autant, mais elle a été récupérée par le marché. C’est une vision bien naïve : dès le départ, la contre-culture était aussi un culte de la consommation –tout alternative qu’elle puisse être- doté d’un marché qui ne fonctionnait pas différemment du marché grand public. Ce que l’écrivain nous montre de la commercialisation de la révolte des années ’90, elle aurait pu le dire de celle des années ’70. La différence ? Elle ne connaît sans doute cette dernière qu’à travers les documents plus ou moins romantiques qu’on trouve chez les libraires alternatifs.
Stylistiquement, d’autres l’ont dit avant, Spiotta évoque Joan Didion – mais sans l’élégance ni, peut-être, la subtilité que la grande dame californienne a dans sa manière d’écrire sur et de traiter un sujet. J’ai été plusieurs fois surpris par la langue beaucoup trop riche de Jason, 15 ans. Qui, à cet âge là, utilise l’expression « lingua franca » ? Par ailleurs, il y a beaucoup à dire sur sa collection de vinyles rares d’une valeur inestimable, apparemment obtenue sans autre source de revenu que l’argent de poche accordé par une mère qui donne des cours du soir de cuisine…
Ce livre n’est pas déplaisant, il se laisse lire. Cependant, rien, ni dans le style ni dans le contenu, ne retient assez l’attention pour qu’il fonctionne et se transforme en lecture nécessaire. Le sujet que Spiotta est potentiellement riche, et je suis certain qu’on aura un jour un grand roman là-dessus. Pour le moment, si vous voulez vous plonger dans les restes de la contre-culture, lisez « Vineland ». Si ce que vous recherchez est une vision plus académique, les rayons sont pleins chez votre libraire indépendant. A la Fnac aussi, d’ailleurs.
Dana Spiotta, Eat the document, Scribner, $24.00
------------------
Cet article est le quatrième d'une série de cinq consacrée aux finalistes du National Book Award 2006. Le premier, le deuxième et le troisième sont déjà en ligne. Le dernier suivra la semaine prochaine.